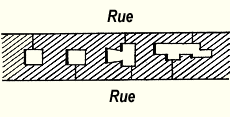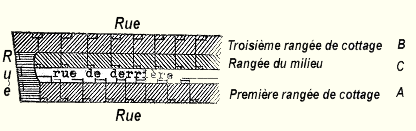La situation des classes laborieuses en Angleterre
Friedrich Engels
Les grandes villes
Une ville comme Londres, où l’on peut marcher des heures sans même parvenir au commencement de la fin, sans découvrir le moindre indice qui signale la proximité de la campagne, est vraiment quelque chose de très particulier.
Cette centralisation énorme, cet entassement de 3,5 millions d’êtres humains en un seul endroit a centuplé la puissance de ces 3,5 millions d’hommes. Elle a élevé Londres au rang de capitale commerciale du monde, créé les docks gigantesques et rassemblé les milliers de navires, qui couvrent continuellement la Tamise. Je ne connais rien qui soit plus imposant que le spectacle offert par la Tamise, lorsqu’on remonte le fleuve depuis la mer jusqu’au London Bridge. La masse des maisons, les chantiers navals de chaque côté, surtout en amont de Woolwich, les innombrables navires rangés le long des deux rives, qui se serrent de plus en plus étroitement les uns contre les autres et ne laissent finalement au milieu du fleuve qu’un chenal étroit, sur lequel une centaine de bateaux à vapeur se croisent en pleine vitesse – tout cela est si grandiose, si énorme, qu’on en est abasourdi et qu’on reste stupéfait de la grandeur de l’Angleterre avant même de poser le pied sur son sol((C’était, il y a presque cinquante ans, à l’époque des pittoresques voiliers. Ceux-ci – il en arrive encore à Londres – se trouvent actuellement dans les docks, la Tamise est couverte de hideux vapeurs, noirs de suie. (1892) )).
Quant aux sacrifices que tout cela a coûté, on ne les découvre que plus tard. Lorsqu’on a battu durant quelques jours le pavé des rues principales, qu’on s’est péniblement frayé un passage à travers la cohue, les files sans fin de voitures et de chariots, lorsqu’on a visité les « mauvais quartiers » de cette métropole, c’est alors seulement qu’on commence à remarquer que ces Londoniens ont dû sacrifier la meilleure part de leur qualité d’hommes, pour accomplir tous les miracles de la civilisation dont la ville regorge, que cent forces, qui sommeillaient en eux, sont restées inactives et ont été étouffées afin que seules quelques-unes puissent se développer plus largement et être multipliées en s’unissant avec celles des autres. La cohue des rues a déjà, à elle seule, quelque chose de répugnant, qui révolte la nature humaine. Ces centaines de milliers de personnes, de tout état et de toutes classes, qui se pressent et se bousculent, ne sont-elles pas toutes des hommes possédant les mêmes qualités et capacités et le même intérêt dans la quête du bonheur ? Et ne doivent-elles pas finalement quêter ce bonheur par les mêmes moyens et procédés ? Et, pourtant, ces gens se croisent en courant, comme s’ils n’avaient rien de commun, rien à faire ensemble, et pourtant la seule convention entre eux est l’accord tacite selon lequel chacun tient sur le trottoir sa droite, afin que les deux courants de la foule qui se croisent ne se fassent pas mutuellement obstacle ; et pourtant, il ne vient à l’esprit de personne d’accorder à autrui ne fût-ce qu’un regard. Cette indifférence brutale, cet isolement insensible de chaque individu au sein de ses intérêts particuliers, sont d’autant plus répugnants et blessants que le nombre de ces individus confinés dans cet espace réduit est plus grand. Et même si nous savons que cet isolement de l’individu, cet égoïsme borné sont partout le principe fondamental de la société actuelle, ils ne se manifestent nulle part avec une impudence, une assurance si totales qu’ici, précisément, dans la cohue de la grande ville. La désagrégation de l’humanité en monades, dont chacune a un principe de vie particulier et une fin particulière, cette atomisation du monde est poussée ici à l’extrême.
Il en résulte aussi que la guerre sociale, la guerre de tous contre tous, est ici ouvertement déclarée. Comme l’ami Stirner((NdE : STIRNER Max, pseudonyme de Johann Caspar SCHMIDT (1806-1856) : Philosophe et écrivain allemand. Un des idéologues de l’individualisme bourgeois et de l’anarchisme. Son œuvre la plus connue est Der Einzige und sein Eigenthum (I’Unique et sa propriété), Leipzig, 1845.)) , les gens ne se considèrent réciproquement que comme des sujets utilisables ; chacun exploite autrui et le résultat c’est que le fort foule aux pieds le faible et que le petit nombre de forts, c’est-à-dire les capitalistes s’approprient tout, alors qu’il ne reste au grand nombre des faibles, aux pauvres, que leur vie et encore tout juste.
Et ce qui est vrai de Londres, l’est aussi de Manchester, Birmingham et Leeds, c’est vrai de toutes les grandes villes. Partout indifférence barbare, dureté égoïste d’un côté et misère indicible de l’autre, partout la guerre sociale, la maison de chacun en état de siège, partout pillage réciproque sous le couvert de la loi, et le tout avec un cynisme, une franchise tels que l’on est effrayé des conséquences de notre état social, telles qu’elles apparaissent ici dans leur nudité et qu’on ne s’étonne plus de rien, sinon que tout ce monde fou ne se soit pas encore disloqué.
Dans cette guerre sociale, le capital, la propriété directe ou indirecte des subsistances et des moyens de production, est l’arme avec laquelle on lutte ; aussi est-il clair comme le jour, que le pauvre supporte tous les désavantages d’un tel état. Personne ne se soucie de lui ; jeté dans ce tourbillon chaotique, il lui faut se débattre tant bien que mal. S’il est assez heureux pour trouver du travail, c’est-à-dire si la bourgeoisie lui fait la grâce de s’enrichir à ses dépens, un salaire l’attend, qui suffit à peine à le maintenir sur cette terre ; ne trouve-t-il pas de travail, il peut voler, s’il ne craint pas la police, ou bien mourir de faim et là aussi la police veillera à ce qu’il meure de faim d’une façon tranquille, nullement blessante pour la bourgeoisie.
Durant mon séjour en Angleterre, la cause directe du décès de vingt à trente personnes a été la faim, dans les conditions les plus révoltantes, et au moment de l’enquête mortuaire, il s’est rarement trouvé un jury qui ait eu le courage de le faire savoir clairement. Les dépositions des témoins avaient beau être limpides, dépourvues de toute équivoque, la bourgeoisie – au sein de laquelle le jury avait été choisi – trouvait toujours un biais qui lui permettait d’échapper à ce terrible verdict : mort de faim . La bourgeoisie, dans ce cas, n’a pas le droit de dire la vérité, ce serait en effet se condamner soi-même. Mais, indirectement aussi, beaucoup de personnes sont mortes de faim – encore bien plus que directement – car le manque continuel de denrées alimentaires suffisantes a provoqué des maladies mortelles, et fait ainsi des victimes ; elles se sont trouvées si affaiblies que certains cas, qui dans d’autres circonstances auraient évolué favorablement, entraînaient nécessairement de graves maladies et la mort. Les ouvriers anglais appellent cela le crime social, et accusent toute la société de le commettre continuellement. Ont-ils tort ?
Bien sûr, il ne meurt de faim que des individus isolés, mais sur quelles garanties le travailleur peut-il se fonder pour espérer que ce ne sera pas son tour demain ? Qui lui assure son emploi ? Qui donc lui garantit que, s’il est demain mis à la porte par son patron pour quelque bonne ou mauvaise raison que ce soit, il pourra s’en tirer, lui et sa famille, jusqu’à ce qu’il en trouve un autre, qui lui « donne du pain ? » Qui donc certifie au travailleur que la volonté de travailler suffit à obtenir du travail, que la probité, le zèle, l’économie et les nombreuses autres vertus que lui recommande la sage bourgeoisie, sont pour lui réellement le chemin du bonheur ? Personne. Il sait qu’il a, aujourd’hui, quelque chose et qu’il ne dépend pas de lui de l’avoir encore demain ; il sait que le moindre souffle, le moindre caprice du patron, la moindre conjoncture commerciale défavorable, le rejettera dans le tourbillon déchaîné auquel il a échappé temporairement, et où il est difficile, souvent impossible, de se maintenir à la surface. Il sait que s’il peut vivre aujourd’hui, il n’est pas sûr qu’il le puisse demain.
Cependant, passons maintenant à un examen plus détaillé de l’état où la guerre sociale plonge la classe qui ne possède rien. Voyons quel salaire la société paye au travailleur en échange de son travail, sous forme d’habitation, d’habillement et de nourriture, quelle existence elle assure à ceux qui contribuent le plus à l’existence de la société ; considérons d’abord les habitations.
Toute grande ville a un ou plusieurs « mauvais quartiers » – où se concentre la classe ouvrière. Certes, il est fréquent que la pauvreté réside dans des venelles cachées tout près des palais des riches, mais en général, on lui a assigné un terrain à part, où, dérobée au regard des classes plus heureuses, elle n’a qu’à se débrouiller seule, tant bien que mal. Ces « mauvais quartiers » sont organisés en Angleterre partout à peu près de la même manière, les plus mauvaises maisons dans la partie la plus laide de la ville ; le plus souvent ce sont des bâtiments à deux étages ou à un seul, en briques, alignés en longues files, si possible avec des caves habitées et presque toujours bâtis irrégulièrement. Ces petites maisons de trois ou quatre pièces et une cuisine s’appellent des cottages et elles constituent communément dans toute l’Angleterre, sauf quelques quartiers de Londres, les demeures de la classe ouvrière. Les rues elles-mêmes ne sont habituellement ni planes, ni pavées ; elles sont sales, pleines de détritus végétaux et animaux, sans égouts ni caniveaux, mais en revanche, parsemées de flaques stagnantes et puantes. De plus, l’aération est rendue difficile par la mauvaise et confuse construction de tout le quartier, et comme beaucoup de personnes vivent ici dans un petit espace, il est aisé d’imaginer quel air on respire dans ces quartiers ouvriers. En outre, les rues servent de séchoir, par beau temps ; on tend des cordes d’une maison à celle d’en face, et on y suspend le linge humide.
Examinons quelques-uns de ces mauvais quartiers. Il y a d’abord Londres(( Depuis que j’ai rédigé cette description, j’ai eu sous les yeux un article sur les quartiers ouvriers de Londres, dans l’Illuminated Magazine* (octobre 1844) qui concorde en maint passage presque mot pour mot avec la mienne. Il est intitulé « The Dwellings of the Poor, from the notebook of a M. D. » [« Les habitations des pauvres, d’après le carnet d’un M. D. » (Docteur en médecine).] (F. E.). – Pp. 336-340. Seules les initiales de l’auteur J. H. figurent sur ce magazine dont un exemplaire existe au British Museum.)), et à Londres, la célèbre « Nichée de Corbeaux » (Rookery), St Giles, où l’on va seulement percer quelques larges rues et qui doit ainsi être détruit. Ce St Giles est situé au milieu de la partie la plus peuplée de la ville, entouré de rues larges et lumineuses, où s’affaire le beau monde londonien – tout près de Oxford Street, de Regent Street, de Trafalgar Square et du Strand. C’est une masse de maisons à trois ou quatre étages, bâties sans plan, avec des rues étroites, tortueuses et sales où règne une animation aussi intense que dans les rues principales qui traversent la ville, à cela près qu’on ne voit à St Giles que des gens de la classe ouvrière. Le marché se tient dans les rues : des paniers de légumes et de fruits, naturellement tous de mauvaise qualité et à peine comestibles, réduisent encore le passage, et il en émane, comme des boutiques de boucher, une odeur écœurante. Les maisons sont habitées de la cave aux combles, aussi sales à l’extérieur qu’à l’intérieur, et ont un aspect tel que personne n’éprouverait le désir d’y habiter. Mais cela n’est rien encore auprès des logements dans les cours et les venelles transversales où l’on accède par des passages couverts et où la saleté et la vétusté dépassent l’imagination ; on ne voit pour ainsi dire pas une seule vitre intacte, les murs sont lépreux, les chambranles des portes et les cadres des fenêtres sont brisés ou descellés, les portes – quand il y en a – faites de vieilles planches clouées ensemble ; ici, même dans ce quartier de voleurs, les portes sont inutiles parce qu’il n’y a rien à voler. Partout des tas de détritus et de cendres et les eaux usées déversées devant les portes finissent par former des flaques nauséabondes. C’est là qu’habitent les plus pauvres des pauvres, les travailleurs les plus mal payés, avec les voleurs, les escrocs et les victimes de la prostitution, tous pêle-mêle. La plupart sont des Irlandais, ou des descendants d’Irlandais, et ceux qui n’ont pas encore sombré eux-mêmes dans le tourbillon de cette dégradation morale qui les entoure, s’y enfoncent chaque jour davantage, perdent chaque jour un peu plus la force de résister aux effets démoralisants de la misère, de la saleté et du milieu.
Mais St Giles n’est pas le seul « mauvais quartier » de Londres. Dans ce gigantesque labyrinthe de rues, il existe des centaines et des milliers de voies étroites et de ruelles, dont les maisons sont trop misérables pour quiconque peut encore consacrer une certaine somme à une habitation humaine, et c’est bien souvent tout près des luxueuses maisons des riches que l’on trouve ces refuges de la plus atroce misère. C’est ainsi que récemment, au cours d’un constat mortuaire, on a qualifié un quartier tout proche de Portman Square, place publique très convenable, de séjour « d’une foule d’Irlandais démoralisés par la saleté et la pauvreté ». C’est ainsi que l’on découvre dans des rues comme Long-Acre etc… qui, sans être « chic », sont malgré tout convenables, un grand nombre de logements dans des caves, d’où surgissent des silhouettes d’enfants maladifs et des femmes en haillons à demi mortes de faim. Aux alentours immédiats du théâtre Drury-Lane – le second de Londres -, on trouve quelques-unes des plus mauvaises rues de toute la ville (rues Charles, King et Parker) dont les maisons aussi, ne sont habitées des caves aux combles que par des familles pauvres. Dans les paroisses de St John et de St Margaret, à Westminster habitaient en 1840, selon le journal de la Société de statistiques, 5,366 familles d’ouvriers dans 5,294 « logements » – si on peut leur donner ce nom – hommes, femmes et enfants, mêlés sans souci d’âge ou de sexe, au total 26,830 individus, et les trois quarts du nombre des familles citées ne disposaient que d’une pièce. Dans la paroisse aristocratique de St George, Hanover Square, habitaient, selon la même autorité, 1,465 familles ouvrières, au total environ 6,000 personnes, dans les mêmes conditions ; et là aussi plus des deux tiers des familles entassées chacune dans une seule pièce. Et de quelle façon les classes possédantes n’exploitent-elles pas légalement la misère de ces malheureux chez qui les voleurs eux-mêmes n’espèrent plus rien trouver ! Pour les hideux logements près de Drury-Lane, que nous venons de mentionner on paye les loyers suivants : deux logements à la cave : 3 shillings (1 taler) ; une chambre au rez-de-chaussée, 4 shillings ; au 1° étage 4,5 shillings ; au 2° étage 4 shillings ; mansardes, 3 shillings par semaine. Si bien que les habitants faméliques de Charles Street payent aux propriétaires d’immeubles un tribut annuel de 2,000 livres sterling (14,000 talers) et les 5,366 familles de Westminster déjà citées, un loyer total de 40,000 livres sterling par an (Soit 270,000 talers).
Le plus grand quartier ouvrier cependant se trouve à l’est de la Tour de Londres, à Whitechapel et Bethnal Green, où la grande masse des ouvriers de la cité est concentrée. Écoutons ce que dit M. G. Alston, prédicateur de St Philip, à Bethnal Green, de l’état de sa paroisse :
« Elle compte 1,400 maisons habitées par 2.795 familles soit environ 12,000 personnes. L’espace où habite cette importante population n’atteint pas 400 yards (1,200 pieds) carrés, et dans un tel entassement il n’est pas rare de trouver un homme, sa femme, 4 ou 5 enfants et parfois aussi le grand-père et la grand’mère dans une seule chambre de 10 à 12 pieds carrés, où ils travaillent, mangent et dorment. Je crois qu’avant que l’évêque de Londres n’eût attiré l’attention du public sur cette paroisse si misérable elle était tout aussi peu connue à l’extrémité ouest de la ville que les sauvages d’Australie ou des îles des mers australes. Et si nous voulons connaître personnellement les souffrances de ces malheureux, si nous les observons en train de prendre leur maigre repas et les voyons courbés par la maladie et le chômage, nous découvrirons alors une telle somme de détresse et de misère qu’une nation comme la nôtre devrait avoir honte qu’elles soient possibles. J’ai été pasteur près de Huddersfield durant les trois ans de crise, au pire moment de marasme des usines, mais je n’ai jamais vu les pauvres dans une détresse aussi profonde que depuis, à Bethnal Green. Pas un seul père de famille sur dix dans tout le voisinage qui ait d’autres vêtements que son bleu de travail, et celui-ci est aussi mauvais et aussi déguenillé que possible ; beaucoup même, n’ont pas, pour la nuit d’autres couvertures que ces guenilles et pour lit n’ont qu’un sac rempli de paille et de copeaux . »
Cette description nous montre déjà à quoi ressemblent d’ordinaire ces logements. Nous allons, en outre, suivre les autorités anglaises dans quelques logements de prolétaires où il leur arrive parfois de pénétrer.
A l’occasion d’une inspection mortuaire pratiquée par M. Carter, coroner de Surrey, sur le corps de Ann Galway âgée de quarante-cinq ans, le 16 novembre 1843, les journaux décrivirent le logement de la défunte en ces termes : elle habitait au n° 3, White Lion Court, Bermondsey Street, Londres, avec son mari et son fils âgé de dix-neuf ans, dans une petite chambre, où il n’y avait ni lit, ni draps ni quelque meuble que ce fût. Elle gisait morte à côté de son fils sur un tas de plumes, éparpillées sur son corps presque nu, car il n’y avait ni couverture, ni draps. Les plumes collaient tellement à tout son corps, que le médecin ne put examiner le cadavre, avant qu’il eût été nettoyé ; il le trouva alors totalement décharné et rongé de vermine. A un endroit le sol de la pièce était creusé et ce trou servait de cabinet à la famille.
Le lundi 15 janvier 1844, deux garçons furent amenés devant le tribunal de simple police de Worship Street à Londres, parce que poussés par la faim, ils avaient dérobé dans une boutique, un pied de veau à demi-cuit, et l’avaient instantanément dévoré. Le juge de simple police se vit amené à pousser son enquête et obtint bientôt des policiers les éclaircissements suivants : la mère de ces garçons était la veuve d’un ancien soldat devenu plus tard agent de police et elle avait connu bien des misères avec ses neuf enfants depuis la mort de son mari.
Elle habitait au n° 2, Pools’ Place, Quaker Street, à Spitalfields, dans la plus grande misère. Lorsque l’agent de police arriva chez elle, il la trouva avec six de ses enfants, littéralement entassés dans une petite chambre sur le derrière de la maison, sans autre meuble que deux vieilles chaises d’osier défoncées, une petite table dont deux pieds étaient cassés, une tasse brisée, et un petit plat… Dans l’âtre, tout juste une étincelle de feu, et dans le coin autant de vieux chiffons qu’une femme peut en prendre dans son tablier mais qui servaient de lit à toute la famille. Ils n’avaient pas d’autres couvertures que leurs pauvres vêtements. La pauvre femme raconta qu’elle avait dû vendre son lit l’année précédente, pour se procurer de la nourriture ; ses draps, elle les avait laissés en gage chez l’épicier pour quelques vivres, et elle avait dû tout vendre, pour simplement acheter du pain. Le juge de simple police fit à cette femme une avance assez importante sur la Caisse des Pauvres.
En février 1844, une veuve de 60 ans, Theresa Bishop, fut recommandée avec sa fille malade âgée de vingt-six ans, à la bienveillance du juge de simple police de Malborough Street. Elle habitait au n° 5, Brown Street, Grosvenor Square, dans une petite chambre sur cour, pas plus grande qu’un placard, où il n’y avait pas un seul meuble. Dans un coin, quelques chiffons, où elles dormaient toutes deux ; une caisse servait à la fois de table et de chaise. La mère gagnait quelques sous en faisant des ménages ; le propriétaire dit qu’elles avaient vécu depuis mai 1843 dans cet état, avaient peu à peu vendu ou engagé tout ce qu’elles possédaient encore, et n’avaient pourtant jamais payé leur loyer. Le juge de simple police leur fit adresser une livre sur la Caisse des Pauvres.
Je ne songe nullement à prétendre que tous les travailleurs londoniens vivent dans la même misère que les trois familles citées ; je sais bien que pour un homme qui est écrasé sans merci par la société, dix vivent mieux que lui mais j’affirme que des milliers de braves et laborieuses familles, beaucoup plus braves, beaucoup plus honorables que tous les riches de Londres, se trouvent dans cette situation indigne d’un homme et que tout prolétaire, sans aucune exception, sans qu’il y ait de sa faute et en dépit de tous ses efforts, peut subir le même sort.
Mais après tout, ceux qui possèdent un toit, quel qu’il soit, sont encore heureux auprès de ceux qui n’en ont pas du tout. A Londres 50,000 personnes se lèvent chaque matin sans savoir où elles poseront leur tête la nuit suivante. Les plus heureux d’entre eux sont ceux qui parviennent à disposer pour le soir d’un pence ou deux et vont dans ce qu’on appelle une « maison-dortoir » (Lodging house ) qu’on trouve en grand nombre dans toutes les grandes villes et où on leur donne asile en échange de leur argent. Mais quel asile ! La maison est pleine de lits du haut en bas, 4, 5, 6 lits dans une pièce, autant qu’il peut y en entrer. Dans chaque lit on empile 4, 5, 6 personnes, tant qu’il en peut entrer aussi, malades et bien portants, vieux et jeunes, hommes et femmes, ivrognes et gens qui n’ont pas bu, comme cela se présente, tous pêle-mêle. On s’y dispute, on s’y bat, on s’y blesse, et lorsque les compagnons de lit se supportent c’est encore pire, on y prépare des vols ou l’on s’y livre à des pratiques dont notre langue, qui s’est humanisée, répugne à décrire la bestialité(( C. HUMPHREY HOUSE : The Dickens World , 1941, pp. 217 et suiv.)). Et ceux qui ne peuvent payer un tel gîte ? Eh bien, ceux-là dorment où ils trouvent place, dans les passages, sous les arcades, dans un recoin quelconque, où la police ou les propriétaires les laissent dormir tranquilles ; quelques-uns viennent bien dans les asiles construits çà et là par des oeuvres de bienfaisance privées, d’autres dorment dans les parcs sur des bancs, juste en dessous des fenêtres de la Reine Victoria. Écoutons ce que dit le Times d’octobre 1843.
Il ressort de notre rapport de police d’hier, qu’en moyenne cinquante personnes dorment chaque nuit dans les parcs, sans autre protection contre les intempéries que les arbres et quelques excavations dans les murs. La plupart sont des jeunes filles, qui, séduites par des soldats, ont été amenées dans la capitale et abandonnées dans ce vaste monde, jetées dans la solitude de la misère dans une ville étrangère, victimes inconscientes et précoces du vice.
« C’est en vérité effrayant. Des pauvres, il faut bien qu’il y en ait. Le besoin parviendra à se frayer partout une voie et à s’installer avec toutes ses horreurs au cœur d’une grande ville florissante. Dans les mille ruelles et les venelles d’une métropole populeuse, il y aura toujours nécessairement – nous le craignons – beaucoup de misère qui blesse la vue, et beaucoup qui jamais n’apparaît au grand jour.
Mais que, dans le cercle qu’ont tracé la richesse, la joie, et le luxe, que tout près de la grandeur royale de St James, aux abords du palais étincelant de Bayswater, où se rencontrent l’ancien quartier aristocratique et le nouveau, dans une partie de la ville où le raffinement de l’architecture moderne s’est prudemment gardé de bâtir la moindre cabane pour la pauvreté, dans un quartier qui semble être consacré exclusivement aux jouissances de la richesse, que là précisément viennent s’installer la misère et la faim, la maladie et le vice avec tout leur cortège d’horreurs, rongeant corps après corps, âme après âme !
C’est réellement un état de choses monstrueux. Les plus hautes jouissances que peuvent accorder la santé physique, l’euphorie intellectuelle et les plaisirs des sens relativement innocents, côtoyant immédiatement la plus cruelle misère ! La richesse, riant du haut de ses salons étincelants, riant avec une insouciance brutale tout près des blessures ignorées de l’indigence ! La joie, raillant inconsciemment mais cruellement la souffrance qui tout en bas gémit ! La lutte de tous les contrastes, toutes les oppositions, sauf une : le vice qui mène à la tentation, s’allie à celui qui se laisse tenter… mais que tous les hommes réfléchissent : dans le quartier le plus brillant de la plus riche ville du monde, nuit après nuit, hiver après hiver, il y a des femmes – jeunes par l’âge, vieilles par les péchés et les souffrances, bannies de la société, croupissant dans la faim, la malpropreté et la maladie. Qu’ils pensent et apprennent, non pas à bâtir des théories, mais à agir. Dieu sait qu’il y a là de quoi faire aujourd’hui. »
J’ai parlé plus haut d’asiles pour sans-logis – deux exemples vont nous montrer combien ceux-ci sont encombrés. Un Refuge of the Houseless((Asile pour sans-logis.)) construit récemment dans la Upper Ogle Street, pouvant héberger chaque nuit 300 personnes, a accueilli de son ouverture le 27 janvier, au 17 mars 1844, 2,740 personnes pour une ou plusieurs nuits ; et bien que la saison devînt plus clémente, le nombre des demandes s’accrût considérablement aussi bien dans celui-ci que dans les asiles de White-Cross-Street et de Wapping, et chaque nuit une foule de sans-abri dût être refoulée faute de place. Dans un autre, l’asile central de Playhouse Yard, on a offert 460 lits en moyenne chaque nuit dans les trois premiers mois de l’année 1844, hébergé 6,681 personnes en tout et distribué 96,141 rations de pain. Cependant le comité directeur déclare que cet établissement n’avait suffi dans une certaine mesure à l’affluence des indigents, que lorsque l’asile de l’est avait été également ouvert pour accueillir les sans-abri .
Quittons Londres pour parcourir chacune des autres grandes villes des trois royaumes. Prenons d’abord Dublin, ville dont l’abord par mer est aussi charmant que celui de Londres est imposant ; la baie de Dublin est la plus belle de toutes celles des Îles britanniques et les Irlandais aiment la comparer à celle de Naples. La ville elle-même a aussi de grandes beautés, et ses quartiers aristocratiques ont été construits mieux et avec plus de goût que ceux de n’importe quelle autre ville britannique. Mais en revanche, les districts les plus pauvres de Dublin comptent parmi les plus répugnants et les plus laids qu’on puisse voir. Certes, le caractère national des Irlandais, qui, dans certaines circonstances, ne sont à leur aise que dans la malpropreté, y joue un rôle, mais comme nous trouvons aussi dans toutes les grandes villes d’Angleterre et d’Écosse des milliers d’Irlandais et que toute population pauvre finit nécessairement par sombrer dans la même malpropreté, la misère à Dublin n’a absolument plus rien de spécifique, propre à la ville irlandaise, c’est au contraire un trait commun à toutes les grandes villes du monde entier. Les districts pauvres de Dublin sont extrêmement étendus et la saleté, l’inhabitabilité des maisons, l’abandon où se trouvent les rues, dépassent l’imagination. On peut se faire une idée de la façon dont sont entassés les pauvres, quand on apprend qu’en 1817, d’après le rapport des inspecteurs de la Maison de travail(( Cité dans Dr. W. P. ALISON * F.R.S.E., Fellow and late President of the Royal College of Physicians, etc. : Observations on the Management of the Poor in Scotland and its Effects on the Health of Great Towns. [Observations sur l’administration des Pauvres en Écosse et ses effets sur l’Hygiène des grandes villes] Edimbourg, 1840. L’auteur est un pieux tory et le frère de l’historien Arch. Alison. (F.E.)
* Alison lui-même cite d’après F. BARKER et J. CHEYNE : An account of the Rise, Progress and decline of the Fever lately epidemical in Ireland, IS 2 1, Vol. II, pp. 160-161. Les descriptions d’Engels datent donc un peu.)), 1,318 personnes habitaient dans la Barrack Street dans 52 maisons comptant 390 chambres, et 1,997 personnes dans la Church Street et les alentours, répartis dans 71 maisons comptant 393 chambres ; que
« dans ce district et dans le district avoisinant, il y a une foule de ruelles et de cours à l’odeur nauséabonde (foul), que mainte cave ne reçoit la lumière du jour que par la porte et que dans plusieurs de celles-ci, les habitants couchent sur la terre nue, bien que la plupart d’entre eux aient au moins des châlits, tandis que par exemple Nicholson’s Court contient 151 personnes vivant en 28 petites pièces misérables, dans la plus grande détresse, à tel point que dans tout le bâtiment on n’a pu trouver que deux châlits et deux couvertures. »
La pauvreté est si grande à Dublin qu’une seule organisation de bienfaisance, celle de la Mendicity Association accueille 2,500 personnes par jour, donc un pour cent de la population totale, les nourrissant le jour et les congédiant le soir.
C’est en termes analogues que le Dr Alison parle d’Edimbourg, encore une ville dont la situation splendide lui a valu le nom d’Athènes moderne, et dont le luxueux quartier aristocratique de la ville neuve contraste brutalement avec la misère crasse des pauvres de la vieille ville. Alison affirme que ce vaste quartier est tout aussi sale et hideux que les pires districts de Dublin et que la Mendicity Association aurait une aussi forte proportion de miséreux à secourir que dans la capitale irlandaise ; il dit même, que les pauvres en Écosse, surtout à Edimbourg et à Glasgow ont la vie plus dure que dans n’importe quelle autre région de l’Empire britannique et que les plus misérables ne sont pas des Irlandais mais des Écossais. Le prédicateur de la vieille église d’Edimbourg, le Dr Lee, déclara en 1836 devant la Commission of Religious Instruction qu’
« il n’avait vu nulle part auparavant une misère comme celle de sa paroisse. Les gens n’avaient pas de meubles, vivaient sans rien ; fréquemment deux couples vivaient dans une pièce. En une journée il s’était rendu dans sept maisons différentes, où il n’y avait pas de lit – dans quelques-unes même pas de paille – des octogénaires dormaient sur le plancher, presque tous gardaient la nuit leurs vêtements de jour ; dans une cave, il avait trouvé deux familles originaires de la campagne ; peu de temps après leur arrivée à la ville, deux enfants étaient morts, le troisième était à l’agonie lors de sa visite ; pour chaque famille il y avait un tas de paille sale dans un coin, et par-dessus le marché, la cave, qui était si sombre qu’on n’y pouvait distinguer un être humain en plein jour, servait d’écurie à un âne. Un cœur aussi dur que le diamant devrait saigner, à la vue d’une telle misère dans un pays comme l’Écosse. »
Le Dr Hennen rapporte des faits analogues dans l’Edinburgh Medical and Surgical journal. Un rapport parlementaire(( Report to the Home Secretary from the Poor Law Commissioners on an Inquiry into the Sanitary Condition of the Labouring Classes of Great Britain. With Appendices. Presented to both Houses of Parliament in July 1842. [Rapport des commissaires pour la loi sur les pauvres présenté au Ministre de l’Intérieur, au sujet d’une enquête sur la situation sanitaire de la classe ouvrière de Grande-Bretagne. Avec appendices. présenté aux deux Chambres du Parlement en juillet 1842].13 volumes in folio ; rassemblé et classé d’après des rapports médicaux, par Edwin Chadwick, secrétaire de la Commission de la loi sur les pauvres*. (F. E.) – Cf. 1843, XII, p. 395.)) montre quelle malpropreté – comme on peut s’y attendre dans de telles conditions – règne dans les maisons des pauvres d’Edimbourg. Des poules ont fait des montants des lits leur perchoir pour la nuit, des chiens et même des chevaux dorment avec les hommes dans une seule et même pièce, et la conséquence naturelle est qu’une saleté et une puanteur effroyables remplissent ces logements, ainsi qu’une armée de vermine de toute espèce. La façon dont Edimbourg est bâtie favorise cet épouvantable état de choses au plus haut point. La vieille ville est construite sur les deux versants d’une colline, sur la crête de laquelle court la Rue haute (High Street). De celle-ci partent des deux côtés une foule de ruelles étroites et tortueuses, appelées en raison de leurs nombreuses sinuosités des wynds, qui dévalent la colline et constituent le quartier prolétarien. Les maisons des villes écossaises sont hautes de 5 à 6 étages comme à Paris et – contrairement à celles d’Angleterre, où autant que possible chacun possède sa maison particulière – habitées par un grand nombre de familles différentes ; la concentration de nombreuses personnes sur une surface réduite en est encore accrue.
Ces rues, dit un journal anglais dans un article sur l’état sanitaire des ouvriers des villes(( The Artizan, 1843, cahier d’octobre. Revue mensuelle* (F. E.)
* P. 230, reproduit dans le Northern Star, n° 313, 11 novembre 1843. Cet article est le troisième d’une série sur « L’état sanitaire des classes laborieuses dans les grandes villes ».)),
« ces rues sont fréquemment si étroites que l’on peut passer d’une fenêtre à celle de la maison d’en face, et ces immeubles présentent en outre un tel entassement d’étages que la lumière peut à peine pénétrer dans la cour ou la ruelle qui les sépare. Dans cette partie de la ville, il n’y a ni égouts, ni cabinets ou lieux d’aisances faisant partie des maisons, et c’est pourquoi tous les immondices, détritus ou excréments d’au moins 50,000 personnes sont jetés chaque nuit dans les caniveaux, si bien que, malgré le balayage des rues, il y a une masse d’excréments séchés aux émanations nauséabondes, qui non seulement offense la vue et l’odorat, mais présente en outre un extrême danger pour la santé des habitants. Est-il étonnant que dans de telles localités, on néglige de prêter la moindre attention à la santé, aux bonnes mœurs et même aux règles les plus élémentaires de la bienséance ? Au contraire, tous ceux qui connaissent bien la situation des habitants, témoigneront du haut degré qu’ont atteint ici la maladie, la misère et l’absence de morale. La société est tombée dans ces régions à un niveau indescriptiblement bas et misérable. Les logements de la classe pauvre sont en général très sales et apparemment jamais nettoyés, de quelque façon que ce soit ; ils se composent dans la plupart des cas, d’une seule pièce – où, bien que l’aération y soit des plus mauvaises, il fait toujours froid à cause des fenêtres cassées, mal adaptées – qui est parfois humide et parfois au sous-sol, toujours mal meublée, et tout à fait inhabitable, au point qu’un tas de paille sert souvent de lit à une famille tout entière, lit où couchent dans un pêle-mêle révoltant, hommes et femmes, jeunes et vieux. On ne peut se procurer de l’eau qu’aux pompes publiques, et la difficulté qu’on a à l’aller quérir, favorise naturellement toutes les saletés possibles. »
Les autres grands ports ne valent guère mieux. Liverpool malgré tout son trafic, son luxe et sa richesse, traite cependant ses travailleurs avec la même barbarie. Un bon cinquième de la population, soit plus de 45,000 personnes habitent dans des caves exiguës, sombres, humides et mal aérées, au nombre de 7,862 dans la ville. A cela s’ajoutent encore 2,270 cours (courts), c’est-à-dire de petites places fermées des quatre côtés et n’ayant comme accès et sortie qu’un étroit passage, le plus souvent voûté – et qui par conséquent ne permet pas la moindre aération, la plupart du temps très sales et habitées presque exclusivement par des prolétaires. Nous aurons à reparler de ces cours, lorsque nous en arriverons à Manchester. A Bristol, on a eu l’occasion de visiter 2,800 familles d’ouvriers dont 46 % n’avaient qu’une seule pièce.
Et nous trouvons exactement la même chose dans les villes industrielles. A Nottingham il y a en tout 11,000 maisons dont 7,000 ou 8,000 sont adossées les unes aux autres de sorte qu’aucune aération complète n’est possible, de plus il n’existe la plupart du temps qu’un lieu d’aisances commun à plusieurs maisons. Une inspection récente révéla que plusieurs files de maisons étaient bâties sur des canaux de décharge peu profonds, qui n’étaient recouverts que par les lattes du plancher.
A Leicester, Derby, et Sheffield, il en va de même. Quant à Birmingham l’article de l’Artizan cité plus haut, rapporte ce qui suit :
« Dans les vieux quartiers de la ville, il y a de mauvais coins, sales et mal entretenus, pleins de flaques stagnantes et de tas d’immondices. A Birmingham, les cours sont très nombreuses, il y en a plus de 2,000 et elles contiennent la plus grande partie de la classe ouvrière. Elles sont le plus souvent exiguës, boueuses, mal aérées, avec des conduits d’évacuation défectueux, groupent de 8 à 20 immeubles qui pour la plupart ne peuvent prendre l’air que d’un côté, parce que le mur du fond est mitoyen, et au bout de la cour il y a presque toujours un trou pour les cendres ou quelque chose de ce genre, dont la saleté est indescriptible. Il faut cependant noter que les cours modernes ont été construites plus intelligemment et qu’elles sont tenues plus convenablement ; et même dans celles-ci, les cottages sont moins tassés qu’à Manchester et Liverpool : ceci explique aussi qu’il y ait eu, au moment des épidémies, moins de cas mortels à Birmingham que par exemple à Wolverhampton, Dudley et Bilston, qui n’en sont éloignées que de quelques lieues. De même, il n’y a pas à Birmingham de logement dans les sous-sols, bien que certaines caves servent improprement d’ateliers. Les maisons-dortoirs pour prolétaires sont un peu plus nombreuses (plus de 400) principalement dans les cours du centre de la ville ; elles sont presque toutes d’une saleté repoussante, mal aérées, véritables refuges pour mendiants, vagabonds trampers (nous reviendrons sur la signification de ce mot), voleurs et prostituées, qui sans aucun égard aux convenances ou au confort mangent, boivent, fument et dorment dans une atmosphère que seuls ces êtres dégradés peuvent supporter. »
Glasgow sur bien des points, ressemble à Edimbourg : mêmes wynds, mêmes hautes maisons. L’Artizan note à propos de cette ville :
« La classe ouvrière constitue ici environ 78 % de la population totale (de l’ordre de 300,000 et elle habite dans des quartiers qui dépassent en misère et horreur les antres les plus vils de St Giles et Whitechapel, les Liberties de Dublin, les wynds d’Edimbourg. Il y a quantité d’endroits semblables au cœur de la ville, au sud de Trongate, à l’ouest du marché au sel, dans le Calton, à côté de la Rue Haute, etc… labyrinthes interminables de ruelles étroites ou wynds, et où débouchent presque à chaque pas des cours ou des culs-de-sac, constitués par de vieilles maisons mal aérées, très hautes, sans eau et décrépites. Ces maisons regorgent littéralement d’habitants ; chaque étage compte 3 ou 4 familles – peut-être 20 personnes – et parfois chaque étage est loué comme dortoir pour la nuit, de sorte que 15 ou 20 personnes sont entassées – nous n’osons pas dire hébergées – dans une seule pièce. Ces quartiers abritent les membres les plus pauvres, les plus dépravés, les moins valables de la population et il faut y voir l’origine des terribles épidémies de fièvre qui, partant de là, ravagent Glasgow tout entier. »
Écoutons la description que fait de ces quartiers, J. C. Symons, commissaire du gouvernement pour l’enquête sur la situation des tisserands manuels(( Arts and Artisans al home and Abroad [Métiers et artisans dans notre pays et à l’étranger], by J. C. Symons, Edinburgh, 1839. L’auteur, à ce qu’il paraît lui-même Écossais, est un libéral, par conséquent fanatiquement opposé à tout mouvement ouvrier autonome. Les passages cités se trouvent pp. 116 et suiv. (F. E.)
L’autorité de ce commissaire a fait l’objet d’une polémique. Cf. D. WILLIAMS : The Rebecca Riot, 1955, pp. 97-98.)) :
« J’ai vu la misère dans quelques-uns de ses pires aspects aussi bien ici que sur le continent, mais avant d’avoir visité les wynds de Glasgow, je ne croyais pas que tant de crimes, de misère et de maladies puissent exister dans un quelconque pays civilisé. Dans les centres d’hébergement de catégorie inférieure dorment à même le sol dix, douze, voire parfois vingt personnes des deux sexes et de tout âge dans une nudité plus ou moins totale. Ces gîtes sont habituellement si sales, si humides et si délabrés que personne n’y voudrait loger son cheval. »
Et il écrit autre part :
« Les wynds de Glasgow abritent une population fluctuante de 15.000 à 30.000 personnes. Ce quartier se compose uniquement de ruelles étroites et de cours rectangulaires, au milieu desquelles s’élève régulièrement un tas de fumier. Si révoltant que fût l’aspect extérieur de ces lieux, j’étais cependant encore peu préparé à la saleté et à la misère qui règnent à l’intérieur. Dans quelques-uns de ces dortoirs, que nous [le superintendant de police, capitaine Miller et Symons] avons visités de nuit, nous trouvâmes une couche ininterrompue d’êtres humains étendus sur le sol, souvent de 15 à 20, quelques-uns habillés, d’autres nus, hommes et femmes ensemble. Leur lit était fait d’une épaisseur de paille moisie mêlée de quelques chiffons. Il n’y avait que peu de meubles ou pas du tout et la seule chose qui donnât à ces bouges un aspect d’habitation était un feu dans la cheminée. Le vol et la prostitution représentent la principale source de revenus de cette population. Personne ne semblait se donner la peine de nettoyer ces écuries d’Augias, ce Pandemonium, ce conglomérat de crimes, de saleté et de pestilence au cœur de la seconde ville de l’Empire. Une vaste inspection des plus bas quartiers d’autres villes, ne me fit jamais rien voir qui pour l’intensité de l’infection morale et physique, ni la densité relative de la population atteignît à la moitié de cette horreur. La plupart des maisons de ce quartier sont classées par le Court of Guild délabrées et inhabitables, mais ce sont précisément celles qui sont les plus habitées, parce que la loi interdit d’en demander quelque loyer. »
La grande région industrielle au centre de l’île britannique, la zone populeuse du Yorkshire occidental et du Lancashire méridional ne le cède en rien, avec ses nombreuses villes industrielles, aux autres grandes villes. La région lainière du Riding occidental, dans le Yorkshire, est une contrée charmante, un beau pays de collines verdoyantes, dont les hauteurs deviennent de plus en plus abruptes vers l’ouest jusqu’à culminer dans la crête escarpée de Blackston Edge – ligne de partage des eaux entre la mer d’Irlande et la mer du Nord. Les vallées de l’Aire, sur laquelle est située Leeds, et du Calder, qu’emprunte la voie ferrée Manchester-Leeds, comptent parmi les plus riantes d’Angleterre et sont parsemées partout de fabriques, de villages, et de villes ; les maisons grises en moellons ont l’air si pimpantes et si propres auprès des bâtiments de briques, noirs de suie du Lancashire, que c’en est un plaisir. Mais lorsqu’on entre dans les villes mêmes, on trouve peu de choses réjouissantes. La situation de Leeds est bien celle que décrit l’Artizan (revue déjà citée) et que j’ai pu voir moi-même,
« sur une pente douce qui descend dans la vallée de l’Aire. Ce fleuve serpente à travers la ville sur une longueur d’environ un mille et demi(( Partout où il est fait mention de mille sans autre précision, il s’agit de la mesure anglaise ; le degré de l’équateur en compte 69 ½ et, par conséquent, la lieue allemande environ 5. (F. E.)
On sait que cette distance représente 1,609 mètres. Le terme de lieue a été dans le texte souvent remplacé par celui de mille.)) et est sujet, pendant la période du dégel ou après des précipitations violentes à de fortes crues. Les quartiers de l’ouest, situés plus haut, sont propres, pour une si grande ville, mais les quartiers bas autour du fleuve et des ruisseaux qui s’y jettent (becks) sont sales, resserrés et suffisent en somme déjà à abréger la vie des habitants, en particulier des petits enfants ; à ajouter encore l’état dégoûtant dans lequel se trouvent les quartiers ouvriers autour de Kirkgate, March Lane, Cross Street et Richmond Road, qui se signalent particulièrement par des rues mal pavées et sans caniveau, une architecture irrégulière, de nombreuses cours et culs de sac et l’absence totale des moyens les plus ordinaires de nettoiement. Tout cela pris ensemble nous fournit bien assez de raisons pour expliquer la mortalité excessive dans ces malheureux fiefs de la plus sordide misère. En raison des crues de l’Aire (qui, il faut l’ajouter, comme tous les fleuves utilisables pour l’industrie, entre dans la ville claire, transparente, pour en ressortir poisseuse, noire et puante de tous les immondices imaginable), les habitations et les caves se remplissent fréquemment d’eau au point qu’il faut la pomper pour la rejeter dans la rue ; et à ces moments-là, l’eau remonte, même là où il y a des égouts, de ceux-ci dans les caves(( Qu’on n’oublie pas que ces « caves » ne sont pas des débarras mais des logements où vivent des êtres humains.)), provoquant des émanations miasmatiques, à forte proportion d’hydrogène sulfureux et laissant un dépôt écœurant extrêmement préjudiciable à la santé. Lors des inondations de printemps de l’année 1839, les effets d’un semblable engorgement des cloaques furent si nocifs, que, selon le rapport de l’officier d’état civil de ce quartier, il y eut ce trimestre trois décès pour deux naissances, alors que, durant le même trimestre, tous les autres quartiers enregistraient trois naissances pour deux décès. »
D’autres quartiers à forte densité de population, sont dépourvus de tout caniveau, ou en sont si mal pourvus qu’ils n’en tirent aucun profit. Dans certaines enfilades de maisons les caves sont rarement sèches ; dans d’autres quartiers, plusieurs rues sont recouvertes d’une fange molle où l’on enfonce jusqu’aux chevilles. Les habitants se sont vainement efforcés de réparer ces rues de temps à autre, en jetant quelques pelletées de cendres ; néanmoins purin et eaux sales répandus devant les maisons stagnent dans tous les trous, jusqu’à ce que vent et soleil les aient séchés (cf. rapport du Conseil municipal dans le Statistical Journal, vol. 2, p. 404). Un cottage ordinaire à Leeds n’occupe pas une superficie supérieure à 5 yards carrés et se compose habituellement d’une cave, d’une salle commune et d’une chambre à coucher. Ces logements exigus, emplis jour et nuit d’êtres humains représentent un autre danger pour les mœurs comme pour la santé des habitants. Et à quel point les gens s’entassent dans ces logements, le rapport cité plus haut, sur l’état sanitaire de la classe ouvrière, nous le dit :
« A Leeds, nous trouvâmes des frères et des sœurs et des pensionnaires des deux sexes, partageant la chambre des parents ; le sentiment humain frémit d’avoir à considérer les conséquences qui en résultent. »
Il en va de même à Bradford, qui n’est qu’à sept lieues de Leeds, au confluent de plusieurs vallées, au bord d’une petite rivière aux eaux toutes noires et nauséabondes. Du haut des collines qui l’entourent, la ville offre par un beau dimanche – car en semaine, elle est enveloppée dans un nuage gris de fumée de charbon – un magnifique panorama, mais à l’intérieur, c’est la même saleté et le même inconfort qu’à Leeds. Les vieux quartiers, sur des versants raides, sont resserrés et irrégulièrement bâtis ; dans les ruelles, impasses et cours, sont entassées ordures et immondices ; les maisons sont délabrées, malpropres, inconfortables et à proximité immédiate du cours d’eau au fond même de la vallée, j’en ai trouvé plusieurs, dont l’étage inférieur à demi creusé dans le flanc de la colline, était tout à fait inhabitable. D’une manière générale, les quartiers du fond de la vallée, où les logements ouvriers sont comprimés entre les hautes usines, sont les plus mal construits et les plus sales de toute la ville. Dans les quartiers plus récents de cette ville, comme dans ceux, de toute autre cité industrielle, les cottages sont alignés plus régulièrement, mais ont tous les inconvénients qui vont de pair avec la façon traditionnelle de loger les ouvriers et dont nous reparlerons avec plus de détails à propos de Manchester. Il en va de même pour les autres villes du West Riding, notamment pour Barnsley, Halifax et Huddersfield. Cette dernière, par sa situation ravissante et son architecture moderne, de beaucoup la plus belle de toutes les villes industrielles du Yorkshire et du Lancashire, a cependant aussi ses mauvais quartiers ; car un comité désigné par une réunion de citoyens pour inspecter la ville, rapporta le 5 août 1844 :
« Il est notoire, qu’à Huddersfield des rues entières et de nombreuses ruelles et cours ne sont ni pavées, ni pourvues d’égouts ou autres écoulements ; en ces endroits s’entassent les détritus, les immondices et les saletés de toutes sortes, qui y fermentent et pourrissent et presque partout l’eau stagnante s’accumule en flaques ; en conséquence, les logements attenants sont nécessairement malsains et sales, si bien que des maladies y prennent naissance et menacent la salubrité de toute la ville. »
Si nous franchissons la crête de Blackstone-Edge à pied ou si nous empruntons le chemin de fer qui la traverse, nous arrivons sur la terre classique, où l’industrie anglaise a accompli son chef-d’œuvre et d’où partent tous les mouvements ouvriers, dans le Lancashire méridional avec son grand centre Manchester. Ici encore, nous trouvons un joli pays de collines s’abaissant en pente fort douce vers l’ouest, depuis la ligne de partage des eaux jusqu’à la mer d’Irlande, avec les charmantes vallées verdoyantes du Ribble, de l’Irwell, de la Mersey et de leurs affluents ; ce pays qui, un siècle auparavant n’était encore en majeure partie, qu’un marécage à peine habité, maintenant tout semé de villes et de villages, est la zone la plus peuplée d’Angleterre. C’est dans le Lancashire, et notamment à Manchester que l’industrie de l’Empire britannique a son point de départ et son centre ; la Bourse de Manchester est le baromètre de toutes les fluctuations du trafic industriel, et les techniques modernes de fabrication ont atteint à Manchester leur perfection. Dans l’industrie cotonnière du Lancashire méridional, l’utilisation des forces de la nature, l’éviction du travail manuel par les machines (en particulier, dans le métier à tisser mécanique et la Self-actor Mule) et la division du travail paraissent à leur apogée ; et si nous avons reconnu en ces trois éléments les caractéristiques de l’industrie moderne, il nous faut bien avouer que, sur ce point aussi, l’industrie de transformation du coton a gardé sur les autres branches industrielles l’avance qu’elle avait acquise dès le début. Mais c’est là aussi que, simultanément, les conséquences de l’industrie moderne devaient se développer le plus complètement et sous la forme la plus pure, et le prolétariat industriel se manifester de la façon la plus classique ; l’abaissement où l’utilisation de la vapeur, des machines et de la division du travail plongent le travailleur et les efforts du prolétariat pour s’arracher à cette situation dégradante, devaient nécessairement être, ici également, poussés à l’extrême et c’est ici qu’on devait en prendre la conscience la plus claire. C’est pour ces raisons, donc, parce que Manchester est le type classique de la ville industrielle moderne et aussi parce que je la connais aussi bien que ma ville natale – et mieux que la plupart de ses habitants -que nous nous y arrêterons un peu plus longuement.
Les villes qui entourent Manchester différent peu de la ville centrale en ce qui concerne les quartiers ouvriers, si ce n’est que dans ces villes, les ouvriers représentent si c’est possible, une fraction plus importante encore de la population. Ces agglomérations sont en effet uniquement industrielles et laissent à Manchester le soin de s’occuper de toutes les affaires commerciales ; elles dépendent totalement de Manchester, et ne sont peuplées par conséquent que de travailleurs, d’industriels et de commerçants de deuxième ordre ; tandis que Manchester possède une population commerciale très importante, notamment des maisons de commission et des maisons de détail très réputées. C’est pourquoi Bolton, Preston, Wigan, Bury, Rochdale, Middleton, Heywood, Oldham, Ashton, Stalybridge, Stockport, etc… encore que presque toutes soient des villes de 30, 50, 70 et même 90,000 habitants, ne sont guère que de grands quartiers ouvriers, interrompus seulement par des usines et quelques grandes artères flanquées de boutiques, et comptant quelques avenues pavées, le long desquelles sont aménagés les jardins et les maisons des fabricants qui ressemblent à des villas. Les villes elles-mêmes sont mal et irrégulièrement construites, avec des cours sales, des voies étroites et des arrière-ruelles pleines de fumée de charbon. L’emploi de la brique, primitivement rouge vif mais noircie par la fumée, qui est ici le matériau habituel de construction, leur donne un aspect particulièrement peu avenant. Les habitations au sous-sol sont ici la règle générale ; partout où c’est possible, on aménage ces tanières et c’est là que vit une partie très importante de la population.
Parmi les plus laides de ces villes, il faut ranger avec Preston et Oldham, Bolton, à onze lieues au nord-ouest de Manchester. Cette ville ne possède, pour autant que j’aie pu le remarquer au cours de plusieurs séjours, qu’une seule rue principale, au surplus assez sale, Deansgate, qui sert en même temps de marché, et qui, même par très beau temps, n’est encore qu’un boyau sombre et misérable, bien qu’elle ne comporte en dehors des usines, que des maisons basses à un ou deux étages. Comme partout, la partie ancienne de la ville est particulièrement vétuste et inconfortable. Une eau noire, – ruisseau ou longue suite de flaques pestilentielles ? – la traverse et contribue à empester complètement un air qui n’est rien moins que pur.
Plus loin se trouve Stockport, qui, bien que située sur la rive de la Mersey appartenant au Cheshire, fait cependant partie du district industriel de Manchester. Elle s’étend dans une vallée étroite parallèlement à la Mersey, de sorte que d’un côté la rue descend à pic pour remonter de l’autre en pente aussi accentuée, et que la voie ferrée de Manchester à Birmingham, franchit la vallée au-dessus de la ville sur un grand viaduc. Stockport est connu dans toute la région pour être un des trous les plus sombres et les plus enfumés et offre effectivement – surtout vu du viaduc – un aspect extrêmement peu engageant. Mais celui des rangées de cottages et de caves qu’habitent les prolétaires dans toutes les parties de la ville, depuis le fond de la vallée jusqu’à la crête des collines, l’est encore bien moins. Je ne me souviens pas avoir vu dans une quelconque autre ville de cette région, une telle proportion de sous-sols habités.
A quelques milles à peine au nord-est de Stockport se trouve Ashton-under-Lyne, un des centres industriels les plus récents de la région. Cette ville, située sur le versant d’une colline au pied de laquelle coulent le canal et la rivière Tame, est bâtie, en général, selon un plan moderne et plus régulier. Cinq ou six grandes rues parallèles traversent toute la colline et sont coupées à angle droit par d’autres artères qui descendent vers la vallée. Grâce à cette disposition, les usines sont reléguées hors de la ville proprement dite, à supposer que la proximité de l’eau et de la voie fluviale ne les eût pas toutes attirées au fond de la vallée, où elles se pressent et s’entassent, déversant par leurs cheminées une épaisse fumée. Ce qui fait qu’Ashton a un aspect beaucoup plus avenant que la plupart des autres villes industrielles ; les rues sont larges et propres, les cottages d’un rouge frais ont l’air neuf et très habitables. Mais le nouveau système qui consiste à construire des cottages pour les travailleurs, a aussi ses mauvais côtés ; chaque rue possède une arrière-ruelle cachée où mène un étroit passage latéral et qui, en revanche, est d’autant plus sale. Et même à Ashton – bien que je n’aie pas vu de bâtiments, sinon quelques-uns à l’entrée de la ville qui aient plus de cinquante ans – même à Ashton il y a des rues où les cottages sont laids et vétustes et dont les briques d’angle se délabrent et travaillent, où les murs se lézardent, dont l’enduit à la chaux s’effrite et tombe à l’intérieur ; il y a des rues dont l’aspect sordide et enfumé ne le cède en rien à celui des autres villes de la contrée, si ce n’est qu’à Ashton c’est l’exception et non la règle.
Un mille plus à l’est, il y a Stalybridge, également sur les bords de la Taine. Lorsque venant d’Ashton on franchit la montagne, on découvre sur le sommet, à droite et à gauche, de beaux et grands jardins entourant de magnifiques maisons, genre villas le plus souvent dans le style « élisabéthain », qui est au gothique, ce qu’est la religion protestante anglicane à la religion catholique apostolique et romaine. Cent pas plus loin, et c’est Stalybridge qui apparaît dans la vallée, mais quel contraste saisissant avec ces magnifiques propriétés, et même avec les modestes cottages d’Ashton : Stalybridge est située dans une gorge étroite et tortueuse, bien plus étroite encore que la vallée de Stockport, et dont les deux versants sont recouverts d’un extraordinaire fouillis de cottages, maisons et usines. Dès qu’on y entre, les premiers cottages sont exigus, enfumés, vétustes et délabrés, et toute la ville est bien à leur image. Il y a peu de rues dans le fond étroit de la vallée ; la plupart se croisent et se recroisent, montent et descendent. Dans presque toutes les maisons, le rez-de-chaussée, en raison de cette disposition en pente, est à demi enfoui dans le sol ; et à quelle foule de cours, de ruelles dérobées, et de recoins isolés cette construction sans plan donne naissance, on peut le voir des montagnes, d’où l’on découvre la ville au-dessous de soi, comme si on la survolait. Qu’on ajoute à cela une saleté effroyable, et l’on comprend l’impression répugnante que fait Stalybridge malgré ses charmants environs.
Mais en voilà assez sur ces petites villes. Elles ont toutes leur cachet particulier, mais au total, les travailleurs y vivent exactement comme à Manchester ; aussi ne me suis-je attaché qu’à l’aspect particulier de leur construction ; et je me borne à noter que toutes les remarques générales sur l’état des logements ouvriers à Manchester, s’appliquent aussi en totalité aux villes environnantes. Passons maintenant à ce grand centre lui-même.
Manchester s’étend au pied du versant sud d’une chaîne de collines qui, partant d’Oldham, traverse les vallées de l’Irwell et du Medlock et dont le dernier sommet, le Kersall-Moor, est en même temps le champ de courses et le mons sacer de Manchester. La ville proprement dite est située sur la rive gauche de l’Irwell, entre ce cours d’eau et deux autres plus petits, l’Irk et le Medlock, qui se jettent en cet endroit dans l’Irwell. Sur la rive droite de celui-ci, enserré dans une grande boucle du fleuve, s’étend Salford, plus à l’ouest Pendleton ; au nord de l’Irwell se trouvent Higher et Lower Broughton, au nord de l’Irk : Cheetham Hill ; au sud du Medlock, se trouve Hulme, plus à l’est Chorlton-on-Medlock, plus loin encore, à peu près à l’est de Manchester, Ardwick. Tout cet ensemble est appelé couramment Manchester et compte au moins 400,000 habitants sinon plus. La ville elle-même est construite d’une façon si particulière qu’on peut y habiter des années, en sortir et y entrer quotidiennement sans jamais entrevoir un quartier ouvrier ni même rencontrer d’ouvriers, si l’on se borne à vaquer à ses affaires ou à se promener. Mais cela tient principalement à ce que les quartiers ouvriers – par un accord inconscient et tacite, autant que par intention consciente et avouée – sont séparés avec la plus grande rigueur des parties de la ville réservées à la classe moyenne ou bien alors, quand c’est impossible, dissimulés sous le manteau de la charité. Manchester abrite, en son centre, un quartier commercial assez étendu, long d’environ un demi mille et large d’autant, composé presque uniquement de comptoirs et d’entrepôts (Warehouses). Presque tout ce quartier est inhabité, et durant la nuit désert et vide ; seules les patrouilles de police rôdent avec leurs lanternes sourdes dans les rues étroites et sombres.
Cette partie est sillonnée par quelques grandes artères à l’énorme trafic et dont les rez-de-chaussée sont occupés par de luxueux magasins ; dans ces rues, on trouve çà et là des étages habités, et il y règne jusque tard dans la soirée une assez grande animation. A l’exception de ce quartier commercial, toute la ville de Manchester proprement dite, tout Salford et Hulme, une importante partie de Pendleton et Chorlton, les deux tiers d’Ardwick et quelques quartiers de Cheetham Hill et Broughton, ne sont qu’un district ouvrier qui entoure le quartier commercial comme une ceinture, dont la largeur moyenne est de un mille et demi. Au-delà de cette ceinture, habitent la bourgeoisie moyenne et la haute bourgeoisie – la moyenne bourgeoisie dans des rues régulières, proches du quartier ouvrier, en particulier à Chorlton et dans les régions de Cheetham Hill situées plus bas – la haute bourgeoisie dans les pavillons avec jardins, du genre villa, plus éloignés, à Chorlton et Ardwick, ou bien sur les hauteurs aérées de Cheetham Hill, Broughton et Pendleton, au grand air sain de la campagne, dans des habitations splendides et confortables, desservies toutes les demi-heures ou tous les quarts d’heure par les omnibus qui conduisent en ville. Et le plus beau, c’est que ces riches aristocrates de la finance peuvent, en traversant tous les quartiers ouvriers par le plus court chemin, se rendre à leurs bureaux d’affaires au centre de la ville sans seulement remarquer qu’ils côtoient la plus sordide misère à leur droite et à leur gauche.
En effet, les grandes artères qui, partant de la Bourse, quittent la ville dans toutes les directions, sont flanquées des deux côtés d’une rangée presque ininterrompue de magasins et ainsi sont aux mains de la petite et moyenne bourgeoisie qui, ne serait-ce que pour son propre intérêt, fait grand cas d’un certain décorum et de propreté, et a les moyens de le faire. Certes, ces magasins présentent néanmoins une certaine ressemblance avec les quartiers qui se trouvent derrière eux et ils sont par conséquent plus élégants dans le quartier des affaires et près des quartiers bourgeois que là où ils masquent des cottages ouvriers malpropres ; mais ils suffisent en tout cas à dissimuler aux yeux des riches messieurs et dames à l’estomac robuste et aux nerfs débiles, la misère et la saleté, complément de leur richesse et de leur luxe. Ainsi en est-il, par exemple, de Deansgate qui, de la Vieille Eglise, conduit tout droit vers le sud, au début bordé par des entrepôts et des usines, puis par des boutiques de second ordre et quelques brasseries ; plus au sud, là où il quitte le quartier commercial, par des boutiques moins reluisantes, qui, à mesure qu’on avance, deviennent plus sales et de plus en plus coupées de cabarets et de tavernes ; jusqu’à ce qu’à l’extrémité sud, l’aspect des boutiques ne laisse plus douter de la qualité des clients : ce sont des ouvriers et des ouvriers uniquement. Ainsi en est-il de Market Street, qui part de la Bourse en direction du sud-est ; on trouve d’abord de brillants magasins de premier ordre et aux étages supérieurs des comptoirs et des entrepôts ; plus loin, à mesure qu’on avance (Piccadilly), de gigantesques hôtels et entrepôts ; plus loin encore (London Road) dans la région du Medlock, des usines, des débits de boissons, des boutiques pour la petite bourgeoisie et les ouvriers ; puis près de Ardwick Green, des habitations réservées à la haute et moyenne bourgeoisie, et à partir de là, de grands jardins et de grandes maisons de campagne pour les plus riches industriels et commerçants. De cette façon, on peut, si l’on connaît Manchester, déduire de l’aspect des rues principales, l’aspect des quartiers attenants – mais, de ces rues, on est rarement en mesure d’apercevoir réellement les quartiers ouvriers. je sais fort bien que cette disposition hypocrite des constructions est plus ou moins commune à toutes les grandes villes. Je sais également que les marchands au détail doivent en raison de la nature même de leur commerce, monopoliser les grandes artères ; je sais que partout on voit, dans des rues de ce genre, davantage de belles maisons que de laides, et que la valeur du terrain qui les entoure est plus élevée que dans les quartiers excentriques. Mais nulle part ailleurs qu’à Manchester je n’ai constaté d’isolement aussi systématique de la classe ouvrière, tenue à l’écart des grandes rues, un art aussi délicat de masquer tout ce qui pourrait blesser la vue ou les nerfs de la bourgeoisie. Et cependant, la construction de Manchester, précisément, répond moins que celle de toute autre ville à un plan précis, ou à des règlements de police ; plus que toute autre ville, sa disposition est le fait du hasard, et quand je songe alors à la classe moyenne, déclarant avec empressement que les ouvriers se portent le mieux du monde, j’ai comme l’impression que les industriels libéraux, les « big whigs » de Manchester, ne sont pas tout à fait innocents de cette pudique disposition des quartiers.
Je mentionnerai encore que les établissements industriels se situent presque tous au bord des trois cours d’eau ou des différents canaux qui se ramifient à travers la ville, et j’en viens à la description des quartiers ouvriers proprement dits. Il y a d’abord la vieille ville de Manchester, entre la limite nord du quartier commerçant et l’Irk. Là, les rues, même les meilleures, sont étroites et tortueuses – Todd Street, Long Millgate, Withy Grove et Shudehill par exemple – les maisons sont sales, vétustes, délabrées, et les rues adjacentes tout à fait hideuses.
Lorsque, venant de la Vieille Eglise, on entre dans Long Millgate, on a immédiatement à droite une rangée de maisons ancien style, où pas une seule façade n’est restée verticale ; ce sont les vestiges du vieux Manchester de l’époque pré-industrielle, dont les anciens habitants ont émigré avec leur postérité vers des quartiers mieux bâtis, abandonnant les maisons qu’ils trouvaient trop laides à une race d’ouvriers fortement métissée de sang irlandais. On se trouve ici réellement dans un quartier ouvrier presque pas camouflé, car même les boutiques et mastroquets de la rue ne se donnent pas la peine de paraître propres. Mais ce n’est encore rien en comparaison des ruelles et des arrière-cours, où l’on accède par des boyaux étroits et couverts où deux personnes n’ont pas la place de se croiser.
Il est impossible d’imaginer l’amoncellement désordonné des maisons entassées littéralement les unes sur les autres, véritable défi à toute architecture rationnelle. Et ce ne sont pas seulement les bâtiments datant de l’ancien Manchester qui en sont responsables. C’est à notre époque que la confusion a été poussée à son comble, car partout où l’urbanisme de l’époque précédente laissait encore le moindre espace libre, on a rebâti et rafistolé jusqu’à ce qu’enfin il ne reste plus entre les maisons un pouce de libre où il soit possible de bâtir. Pour preuve, je reproduis ici un tout petit fragment du plan de Manchester : il y a d’ailleurs pire et il ne représente pas le dixième de la vieille ville.
Ce croquis suffira à caractériser l’architecture insensée de tout le quartier, en particulier près de l’Irk. La rive sud de l’Irk est ici très abrupte et haute de 15 à 30 pieds ; sur cette paroi en pente, sont encore plantées le plus souvent, trois rangées de maisons, dont la plus basse émerge directement du fleuve, tandis que la façade de la plus haute se trouve au niveau du sommet des collines de Long Millgate. Dans les intervalles, il y a en plus des usines au bord du cours d’eau. Bref la disposition des maisons est ici tout aussi resserrée et désordonnée que dans la partie basse de Long Millgate.
A droite et à gauche, une foule de passages couverts, mènent de la rue principale aux nombreuses cours et, lorsqu’on y pénètre, on arrive dans une saleté et une malpropreté écœurantes qui n’ont pas leurs pareilles, en particulier dans les cours qui descendent vers l’Irk et où se trouvent vraiment les plus horribles logements qu’il m’ait été donné de voir jusqu’à présent. Dans une de ces cours, il y a juste à l’entrée, à l’extrémité du couloir couvert, des cabinets sales sans porte et si sales, que les habitants ne peuvent entrer ou sortir de la cour qu’en traversant une mare d’urine pestilentielle et d’excréments qui entoure ces cabinets ; c’est la première cour au bord de l’Irk en amont de Ducie Bridge, au cas où quelqu’un désirerait aller y voir ; en bas, sur les rives du cours d’eau il y a plusieurs tanneries, qui emplissent toute la région de la puanteur que dégage la décomposition de matières organiques.
1. La Bourse. – 2. La Vieille Église. – 3. La Maison des pauvres. – 4. Le cimetière des pauvres (la ligne de chemin de fer Leeds-Liverpool passe entre la Maison des pauvres et le cimetière). – 5. L’Église Saint-Michel. – 6. Scotland Bridge (le pont d’Écosse) sur l’Irk (la rue qui va de la Vieille Église à Scotland Bridgeest LongMillgate). – 7. Ducie Bridge sur l’Irk. – 8. La Petite Irlande.
Dans les cours en aval de Ducie Bridge, il faut descendre le plus souvent des escaliers étroits et sales pour accéder aux maisons et franchir des amoncellements de détritus et d’immondices.
La première cour en aval de Ducie Bridge s’appelle Allen’s Court ; lors de l’épidémie de choléra (1832), elle était dans un tel état que les services sanitaires la firent évacuer, nettoyer et désinfecter au chlore ; le Dr Kay fournit dans une brochure(( The Moral and Physical Condition of the Working Classes, employed in the Cotton Manufacture in Manchester. [État physique et moral des classes laborieuses travaillant à Manchester à la fabrication du coton] par James Ph. Kay D. M., 2e édit. 1832. Confond la classe ouvrière en général avec la classe des ouvriers d’industrie; par ailleurs excellent. (F. E.)
On trouve une autre description de Allens’ Court dans Henry GAULTER : The Origin and Progress of the malignant Cholera in Manchester, 1833, pp. 50-51.)) une description effrayante de l’état de cette cour à cette époque-là. Depuis, elle semble avoir été démolie par endroits puis reconstruite ; du haut de Ducie Bridge, on aperçoit en tout cas encore plusieurs pans de murs en ruine et de grands tas de décombres, à côté de maisons de construction plus récente. Le point de vue qu’on a de ce pont – délicatement masqué aux mortels d’assez petite taille par un parapet de pierre à hauteur d’homme – est par ailleurs caractéristique de tout le quartier. En bas, coule, ou plutôt stagne, l’Irk, mince cours d’eau, noir comme la poix et à l’odeur nauséabonde, plein d’immondices et de détritus, qu’il dépose sur sa rive droite qui est plus basse ; par temps sec, il subsiste sur cette rive toute une série de flaques boueuses, fétides, d’un vert noirâtre, du fond desquelles montent des bulles de gaz méphitique dégageant une odeur qui, même en haut sur le pont, à 40 ou 50 pieds au-dessus de l’eau, est encore insupportable. La rivière elle-même, en outre, est retenue presque à chaque pas par de hauts barrages, derrière lesquels se déposent en masse la boue et les déchets qui s’y décomposent.
En amont du pont, s’élèvent de hautes tanneries, plus loin encore des teintureries, des fabriques de noir animal et des usines à gaz dont les eaux usées et les déchets aboutissent tous dans l’Irk qui recueille en outre le contenu des égouts et cabinets qui y débouchent. On peut donc imaginer la nature des résidus qu’abandonne le fleuve. En aval du pont, on a vue sur les tas d’ordures, les immondices, la saleté et le délabrement des cours, situées sur la rive gauche, abrupte ; les maisons sont tassées les unes contre les autres et la pente de la rive ne permet d’apercevoir qu’une fraction de chacune d’elles, toutes noires de fumée, décrépites, vétustes, avec leurs fenêtres aux vitres et aux châssis cassés. L’arrière-plan est constitué par de vieilles bâtisses d’usine, ressemblant à des casernes. Sur la rive droite toute plate, s’élève une longue file de maisons et de fabriques. La seconde maison est en ruines, sans toit, pleine de décombres, et la troisième est si basse que l’étage inférieur est inhabitable et en conséquence sans portes ni fenêtres. L’arrière-plan, de ce côté, c’est le cimetière des pauvres, les gares des chemins de fer de Liverpool et de Leeds et derrière, la Maison des pauvres, « la Bastille de la loi sur les pauvres » de Manchester, qui, pareille à une citadelle, regarde du haut d’une colline, à l’abri de hautes murailles et de créneaux, menaçante, le quartier ouvrier qui s’étend en face.
En amont de Ducie Bridge, la rive gauche s’abaisse et la droite en revanche se fait plus abrupte ; mais l’état des maisons des deux côtés de l’Irk a plutôt tendance à empirer.
Si l’on quitte la rue principale – c’est toujours Long Millgate – en tournant à gauche, on est perdu ; d’une cour, on tombe dans une autre ; ce ne sont que coins de rues, qu’impasses étroites et passages malpropres, et au bout de quelques minutes on est complètement désorienté et l’on ne sait plus du tout où diriger ses pas. Partout, des bâtiments à demi ou complètement en ruines, – quelques-uns sont réellement inhabités et ici, cela veut beaucoup dire – dans les maisons presque jamais de plancher ou de carrelage, par contre, presque toujours des fenêtres et des portes cassées, mal ajustées, et quelle saleté ! Des monceaux de décombres, de détritus et d’immondices partout ; des flaques stagnantes au lieu de caniveau, et une odeur qui à elle seule interdirait à tout homme quelque peu civilisé d’habiter dans un tel quartier. Le prolongement, récemment terminé, du chemin de fer de Leeds, qui traverse ici l’Irk a fait disparaître une partie de ces cours et de ces ruelles, mais il en a par contre exposé d’autres aux regards. C’est ainsi qu’il y a juste en-dessous du pont de chemin de fer, une cour qui dépasse de très loin toutes les autres en saleté et en horreur, précisément parce qu’elle était jusqu’à maintenant tellement à l’écart, tellement retirée qu’on n’y pouvait accéder qu’à grand peine ; je ne l’aurais moi-même jamais découverte sans la trouée faite par le viaduc du chemin de fer, bien que je crusse très bien connaître ce coin. C’est en passant sur une rive inégale, entre des piquets et des cordes à linge que l’on pénètre dans, ce chaos de petites masures à un étage et à une pièce la plupart du temps dépourvue de plancher : cuisine, salle commune et chambre à coucher tout à la fois.
Dans un de ces trous qui mesurait à peine six pieds de long et cinq pieds de large, j’ai vu deux lits – et quels lits et quelle literie ! – qui, avec un escalier et un foyer, remplissaient toute la pièce. Dans plusieurs autres, je ne vis absolument rien, bien que la porte en fût grande ouverte et que les habitants y fussent adossés. Devant les portes, partout des décombres et des ordures ; on ne pouvait voir si, en dessous, c’était pavé, on ne pouvait que le sentir au pied, par endroits. Toute cette foule d’étables, habitées par des hommes, était bornée sur deux côtés par des maisons et une usine, sur le troisième par le cours d’eau et, à part le petit sentier de la rive, on n’en sortait que par une étroite porte cochère qui donnait dans un autre dédale de maisons, presque aussi mal bâties et mal entretenues que celles-ci. Ces exemples suffisent.
C’est ainsi qu’est bâtie toute la rive de l’Irk, chaos de maisons jetées pêle-mêle, plus ou moins inhabitables et dont l’intérieur est en parfaite harmonie avec la saleté des alentours. Mais aussi, comment voulez-vous que les gens soient propres ! Il n’y a même pas de commodités pour les besoins les plus naturels et les plus quotidiens. Les cabinets sont ici si rares, qu’ils sont ou bien pleins chaque jour ou bien trop éloignés pour la plupart des gens. Comment voulez-vous que les gens se lavent, alors qu’ils n’ont à proximité que les eaux sales de l’Irk, et que les canalisations et les pompes n’existent que dans les quartiers honnêtes ? Vraiment on ne peut faire reproche à ces ilotes de la société moderne, si leurs logements ne sont pas plus propres que les porcheries qu’on trouve çà et là au milieu d’eux. Les propriétaires, eux, n’ont pas honte de louer des logements comme les six ou sept sous-sols donnant sur le quai, tout de suite en aval de Scotland Bridge, et dont le sol est au moins à deux pieds au-dessous du niveau des eaux – lorsque les eaux sont basses – de l’Irk qui coule à moins de six pieds de distance – ou bien comme l’étage supérieur de la maison d’angle, sur l’autre rive, juste avant le pont, dont le rez-de-chaussée est inhabitable, sans rien pour boucher les trous des fenêtres et de la porte. C’est un cas qui n’est pas rare dans cette région ; et ce rez-de-chaussée ouvert sert d’ordinaire de lieux d’aisances à tout le voisinage faute de locaux appropriés.
Si nous quittons l’Irk pour entrer de l’autre côté de Long Millgate, au cœur des habitations ouvrières, nous arrivons dans un quartier un peu plus récent qui s’étend depuis l’église St Michel jusqu’à Withy Grove et Shudehill. Ici, du moins, il y a un peu plus d’ordre ; au lieu d’une architecture anarchique, nous trouvons au moins de longues ruelles et impasses rectilignes, ou bien des cours rectangulaires qui ne sont pas dues au hasard ; mais si, précédemment, c’était chaque maison en particulier, ici ce sont les ruelles et les cours qui sont construites arbitrairement, sans aucun souci de la disposition des autres. Tantôt une ruelle va dans telle direction, tantôt dans telle autre, on débouche à chaque pas dans un cul-de-sac ou une encoignure qui vous renvoie d’où vous venez – quiconque n’a pas vécu un bon bout de temps dans ce labyrinthe ne s’y retrouve certainement pas. L’aération des rues – si je puis employer ce mot à propos de ce quartier – et des cours, en est par suite aussi imparfaite qu’aux abords de l’Irk ; et si cependant, on devait reconnaître à ce quartier quelque supériorité sur la vallée de l’Irk – les maisons sont, il est vrai, plus récentes, les rues ont du moins par endroits des caniveaux – il possède aussi en revanche, presque dans chaque maison, un logement au sous-sol, ce qui n’existe que rarement dans la vallée de l’Irk, précisément en raison de la vétusté et du mode de construction moins soigné. Du reste, la, saleté, les tas de décombres et de cendres, les flaques dans les rues sont communs aux deux quartiers et, dans le district dont nous parlons en ce moment, nous constatons en outre un autre fait très préjudiciable à la propreté des habitants : le grand nombre de porcs qui errent partout dans les ruelles fouillant les ordures ou qui sont enfermés à l’intérieur des cours dans de petites porcheries. Les éleveurs de cochons louent ici les cours, comme dans la plupart des quartiers ouvriers de Manchester, et y installent des porcheries ; il y a dans presque toutes les cours un ou plusieurs recoins séparés du reste, où les habitants des lieux jettent toutes leurs ordures et leurs détritus. Les porcs s’en engraissent – et l’atmosphère de ces cours, déjà fermées de tous côtés, en est toute empuantie en raison de la putréfaction des matières animales et végétales. On a percé une rue large et assez convenable à travers ce quartier – Millers street – et dissimulé l’arrière-plan avec assez de bonheur – mais si l’on se laisse entraîner par la curiosité dans un des nombreux passages menant aux cours, on pourra constater tous les vingt pas cette cochonnerie, au sens exact du terme.
Telle est la vieille ville de Manchester – et en relisant ma description, je dois reconnaître que bien loin d’être exagérée, ses couleurs n’en sont pas assez crues pour donner à voir la saleté, la vétusté et l’inconfort, ni à quel point la construction de ce quartier, peuplé de 20,000 à 30,000 habitants au moins, est un défi à toutes les règles de la salubrité, de l’aération et de l’hygiène. Et un tel quartier existe au cœur de la deuxième ville d’Angleterre, de la première ville industrielle du monde. Si l’on veut venir voir de quel espace réduit l’homme a besoin pour se mouvoir, combien peu d’air – et quel air – lui est nécessaire à l’extrême rigueur pour respirer, à quel degré inférieur de civilisation il peut subsister, on n’a qu’à venir en ces lieux. Bien sûr, c’est la vieille ville – et c’est l’argument des gens d’ici, quand on leur parle de l’état épouvantable de cet enfer sur terre – mais, qu’est-ce à dire ? Tout ce qui suscite ici le plus notre horreur et notre indignation est récent et date de l’époque industrielle. Les quelques centaines de maisons qui proviennent du vieux Manchester ont été abandonnées depuis longtemps par leurs premiers habitants ; il n’y a que l’industrie pour les avoir bourrées des troupes d’ouvriers qu’elles abritent actuellement, il n’y a que l’industrie pour avoir fait bâtir sur chaque parcelle qui séparait ces vieilles maisons, afin d’y gagner des abris pour les masses qu’elle faisait venir de la campagne et d’Irlande; il n’y a que l’industrie pour permettre aux propriétaires de ces étables, de les louer au prix fort comme logis à des êtres humains, d’exploiter la misère des ouvriers, de miner la santé de milliers de personnes pour son seul profit ; il n’y a que l’industrie pour avoir fait que le travailleur à peine libéré du servage, ait pu être à nouveau utilisé comme simple matériel, comme une chose, au point qu’il lui faille se laisser enfermer dans un logement trop mauvais pour n’importe qui d’autre et qu’il a le droit de laisser tomber complètement en ruines en échange de ses gros sous. Cela, c’est l’industrie seule qui l’a fait, elle qui n’aurait pas pu exister sans ces ouvriers, sans la misère et l’asservissement de ces ouvriers. C’est vrai, la disposition initiale de ce quartier était mauvaise, on ne pouvait pas en tirer grand chose de bon – mais les propriétaires fonciers et l’administration ont-ils fait quoi que ce soit pour l’améliorer lorsqu’ils se sont mis à y construire ? Au contraire ; là où une parcelle était encore libre, on éleva une maison, où il y avait encore une issue superflue, on l’a murée ; la valeur foncière s’est accrue de pair avec l’essor industriel et plus elle s’élevait, plus on bâtissait frénétiquement, sans aucun égard pour l’hygiène ou le confort des habitants, selon le principe : Si laide que soit une masure, il se trouvera toujours un pauvre incapable d’en payer une plus belle, le seul souci étant celui du plus grand profit possible. Mais que voulez-vous, c’est la vieille ville et c’est avec cet argument que se tranquillise la bourgeoisie ; voyons donc de quoi a l’air la ville neuve (the new town).
La ville neuve, appelée aussi la ville irlandaise (the Irish town), s’étend au delà de la vieille ville sur le flanc d’une colline argileuse entre l’Irk et St George’s Road. Ici disparaît tout aspect urbain. Des rangées isolées de maisons ou formant un ensemble de rues, s’élèvent par endroits comme de petits villages, sur le sol d’argile nu, où ne pousse pas même du gazon ; les maisons ou plutôt les cottages, sont en mauvais état, jamais réparées, sales, avec des logements au sous-sol, humides et malpropres ; les ruelles n’ont ni pavés ni caniveaux ; en revanche elles recèlent de nombreuses colonies de porcs, enfermés dans de petites cours ou des porcheries ou bien errant en toute liberté sur la pente. Les chemins sont ici tellement boueux qu’il faut que le temps soit extrêmement sec, pour pouvoir espérer en sortir sans s’enfoncer à chaque pas jusqu’aux chevilles. Près de St George’s Road, les différents îlots se rejoignent, on s’engage dans une interminable enfilade de ruelles, culs-de-sac, arrière-rues et cours, dont la densité et le désordre s’accroissent à mesure qu’on approche du centre de la ville. Par contre, ces voies sont, il est vrai, assez fréquemment pavées ou, du moins, pourvues de passages pavés pour piétons, et de caniveaux ; mais la saleté, le mauvais état des maisons, et surtout des caves, restent les mêmes.
Il y a lieu de faire ici quelques remarques générales sur la façon dont on bâtit habituellement les quartiers ouvriers à Manchester. Nous avons vu que dans la vieille ville, c’était le plus souvent le hasard qui présidait au groupement des maisons. Chaque maison est bâtie sans souci des autres, et les intervalles de forme irrégulière entre les habitations s’appellent à défaut d’autre terme des cours (courts). Dans les parties un peu plus récentes de ce même quartier, et dans d’autres quartiers ouvriers datant des premiers temps de l’essor industriel, on note une ébauche de plan. L’intervalle séparant deux rues est divisé en cours plus régulières, le plus souvent quadrangulaires : à peu près comme ci-dessous :
Ces cours furent dès le début disposées ainsi ; les rues communiquent avec elles, par des passages couverts. Si ce mode de construction désordonné était déjà très préjudiciable à la santé des habitants, en ce qu’il empêchait l’aération, cette manière d’enfermer les ouvriers dans des cours encloses de tous côtés, l’est encore bien plus. Ici, l’air ne peut rigoureusement pas s’échapper ; les cheminées des maisons – tant que le feu n’est pas allumé – sont les seules évacuations possibles pour l’air pris au piège de la cour (( Et cependant, un sage libéral anglais affirme dans le Childrens’ Empl. Comm. Report que ces cours sont le chef-d’œuvre de l’architecture urbaine, parce qu’elles amélioreraient, telles un grand nombre de petites places publiques l’aération et le renouvellement de l’air ! Ah ! si chaque cour avait deux ou quatre accès se faisant face, larges et non couverts, par où l’air pourrait circuler ! Mais elles n’en ont jamais deux, très rarement un seul découvert, et presque toutes n’ont que des entrées étroites et couvertes. (F. E.)
Cf. R. D. GRAINGER, in Appendix to the 2nd Report of the Children’s Employment Commission, Part. I.)) .
Il s’y ajoute encore que les maisons autour de ces cours sont le plus souvent bâties par deux, leur mur du fond étant mitoyen, et cela suffit déjà à empêcher toute aération satisfaisante et complète. Et, comme la police des rues ne se soucie pas de l’état de ces cours, comme tout ce qui y est jeté y reste bien tranquillement, il ne faut pas s’étonner de la saleté et des tas de cendres et d’ordures qu’on y trouve. Je suis allé dans des cours – près de Millers Street – qui étaient au moins un demi-pied au-dessous du niveau de la rue principale et qui n’avaient pas la moindre rigole d’écoulement pour les eaux de pluie qui s’y amassent !
Plus tard, on a commencé d’adopter un autre style de construction qui est maintenant le plus courant. On ne construit pas les cottages ouvriers isolément, mais toujours par douzaines, voire par grosses – un seul entrepreneur bâtit du même coup une ou plusieurs rues. Celles-ci sont aménagées de la façon suivante : l’une des façades (cf. le croquis ci-dessous) comprend des cottages de premier ordre qui ont la chance de posséder une porte de derrière et une petite cour, et qui rapportent le plus haut loyer. Derrière les murs de la cour de ce cottage, il y a une ruelle étroite, la rue de derrière, (back street), fermée aux deux bouts, et où l’on accède latéralement soit par un chemin étroit, soit par un passage couvert. Les cottages qui donnent sur cette ruelle payent le plus bas loyer, et sont du reste les plus négligés. Leur mur de derrière est mitoyen avec la troisième rangée de cottages qui donnent du côté opposé sur la rue, et rapportent un loyer moins élevé que la première rangée mais plus élevé que la deuxième. La disposition des rues est donc à peu près celle-ci :
Ce mode de construction assure une assez bonne aération au premier rang de cottages et celle de la troisième rangée n’est pas pire que celle de la rangée correspondante dans la disposition antérieure ; par contre la rangée du milieu est au moins aussi mal aérée que les maisons des cours et les ruelles de derrière sont dans le même état de saleté et d’apparence aussi minable que les cours. Les entrepreneurs préfèrent ce type de construction parce qu’elle gagne de la place et leur donne l’occasion d’exploiter plus aisément les travailleurs les mieux payés en leur demandant des loyers plus élevés pour les cottages de la première et de la troisième rangées. Ces trois types de construction de cottages se retrouvent dans tout Manchester – et même dans tout le Lancashire et le Yorkshire – souvent confondus mais plus souvent encore suffisamment distincts pour qu’on puisse en déduire l’âge relatif des différents quartiers de la ville. Le troisième système, celui des « ruelles de derrière », prédomine nettement dans le grand quartier ouvrier, à l’est de St Georges’ Road, des deux côtés de Oldham Road et Great Ancoats Street, il est aussi le plus fréquent dans les autres quartiers ouvriers de Manchester et dans les faubourgs.
C’est dans le grand quartier que nous venons de mentionner et que l’on désigne sous le nom de Ancoats, que sont installées, le long des canaux, la plupart des usines et les plus importantes – bâtiments gigantesques de six à sept étages qui avec leurs cheminées élancées dominent de très haut les bas cottages ouvriers. La population du quartier se compose donc principalement d’ouvriers d’usine et dans les plus mauvaises rues de tisserands manuels. Les rues situées à proximité immédiate du centre de la ville sont les plus vieilles donc les plus mauvaises, elles sont cependant pavées et pourvues de caniveaux ; j’y inclus les rues parallèles les plus proches : Oldham Road et Great Ancoats Street. Plus au nord, on trouve maintes rues de construction récente ; les cottages y sont coquets et propres ; les portes et fenêtres sont neuves et fraîchement peintes, les intérieurs blanchis proprement ; les rues elles-mêmes sont plus aérées, les espaces non bâtis entre elles, plus grands et plus nombreux, mais ceci ne s’applique qu’à la minorité des habitations ; en outre, des logements au sous-sol existent sous presque chaque cottage, beaucoup de rues ne sont pas pavées et n’ont pas de caniveaux et surtout cet air coquet n’est qu’une apparence qui disparaît au bout de dix années. En effet, le mode de construction des différents cottages n’est pas moins condamnable que la disposition des rues. Ces cottages semblent à première vue tous jolis et de bon aloi, les murs de briques massifs captivent le passant et lorsqu’on parcourt une rue ouvrière de construction récente, sans se soucier davantage des ruelles de derrière et de la façon dont sont bâties les maisons elles-mêmes, on abonde dans le sens des industriels libéraux, qui affirment que nulle part les ouvriers ne sont si bien logés qu’en Angleterre. Mais quand on y regarde de plus près, on trouve que les murs de ces cottages sont aussi minces qu’il est possible. Les murs extérieurs qui supportent le sous-sol, le rez-de-chaussée et le toit ont, tout au plus, l’épaisseur d’une brique, ainsi à chaque couche horizontale, les briques sont disposées les unes à côté des autres, dans le sens de la longueur, mais j’ai vu maints
cottages de la même hauteur – quelques-uns même en construction – où les murs extérieurs n’avaient qu’une demi-brique d’épaisseur et où celles-ci, par conséquent, n’étaient pas disposées dans le sens de la longueur, mais dans celui de la largeur :
elles jouxtaient par leur côté étroit. Ceci en partie afin d’économiser les matériaux, en partie aussi parce que les entrepreneurs ne sont jamais les propriétaires du terrain : ils n’ont fait que le louer, à la mode anglaise, pour 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, après quoi il revient, avec tout ce qui s’y trouve, à son premier propriétaire, sans que celui-ci ait à verser quoi que ce soit en dédommagement des installations qui y ont été faites. Le locataire du terrain calcule donc ces installations de sorte qu’elles aient aussi peu de valeur que possible à l’expiration du contrat ; et comme des cottages de ce genre sont bâtis 20 ou 30 ans seulement avant ce terme, il est aisément concevable que les entrepreneurs ne veuillent y faire des frais trop élevés. Il faut ajouter que ces entrepreneurs, la plupart du temps maçons et charpentiers ou industriels, ne font que peu ou pas de réparations, en partie parce qu’ils ne veulent pas réduire le bénéfice des loyers, en partie parce qu’approche l’expiration du bail du terrain bâti et qu’en raison des crises économiques et de la disette qui s’ensuit des rues entières restent souvent désertes : conséquence, les cottages se délabrent rapidement et deviennent inhabitables. De fait, on calcule généralement que les logements ouvriers ne sont habitables en moyenne que quarante ans ; cela peut sembler étrange, lorsqu’on voit. les beaux murs massifs de cottages neufs, qui semblent devoir durer quelques siècles, mais c’est ainsi, la lésinerie qui préside à la construction, l’absence systématique de réparation, l’inoccupation fréquente des logements, le fréquent et perpétuel changement de locataires et, en outre, les dégradations qu’ils commettent (la plupart sont des Irlandais) durant les dix dernières années où le cottage est habitable : ils arrachent assez souvent le bois de charpente pour faire du feu ; tout cela fait qu’au bout de quarante ans, ces cottages ne sont plus que ruines. C’est pour cette raison que le district d’Ancoats, dont les maisons datent seulement de l’essor industriel et même en grande partie seulement de ce siècle, compte malgré tout quantité de cottages vétustes et délabrés, et que la majorité d’entre eux y a déjà atteint le dernier stade de l’habitabilité. Je ne veux point dire ici la quantité de capitaux qui ont été ainsi gaspillés, ni comment un investissement initial un peu plus élevé et de faibles réparations par la suite eussent suffi pour que tout ce quartier pût être maintenu de longues années propre, convenable, et habitable. Ce qui m’intéresse, c’est uniquement la situation des maisons et de leurs habitants et il faut bien dire qu’il n’y a pas, pour loger les ouvriers, de système plus néfaste et plus démoralisant que celui-là.
L’ouvrier est contraint d’habiter ces cottages en mauvais état parce qu’il ne peut pas payer le loyer de meilleurs ou bien parce qu’il n’en existe pas de meilleurs à proximité de l’usine, peut-être même aussi parce que ces cottages appartiennent à l’industriel et que celui-ci n’embauche que ceux qui acceptent d’occuper un de ces logements. Bien entendu cette durée de quarante ans n’est pas à prendre au pied de la lettre car si les logements sont situés dans un quartier à grande densité d’immeubles et si par conséquent, malgré le loyer foncier plus élevé, il y a des chances de trouver toujours des locataires, les entrepreneurs font quelque effort pour assurer l’habitabilité relative de ces logements au-delà des quarante années ; mais même dans ce cas, ils ne dépassent pas le strict minimum et ces habitations retapées sont alors précisément les pires. De temps à autre, lorsqu’on craint des épidémies, la conscience des services d’hygiène, ordinairement très somnolente, s’émeut quelque peu ; ils entreprennent alors des expéditions dans les quartiers ouvriers, ferment toute une série de caves et de cottages, comme ce fut le cas dans plusieurs ruelles des environs de Oldham Road ; mais cela ne dure guère, les logements réprouvés retrouvent bientôt des occupants et les propriétaires n’en sont que plus à l’aise pour trouver des locataires : on sait bien que les policiers des services d’hygiène ne reviendront pas de si tôt !
Cette partie est et nord-est de Manchester est la seule où la bourgeoisie ne soit pas installée, pour la bonne raison que le vent dominant qui souffle dix ou onze mois de l’année de l’ouest et du sud-ouest apporte de ce côté-là, la fumée de toutes les usines – et ce n’est pas peu dire. Cette fumée-là, les ouvriers peuvent bien la respirer tout seuls.
Au sud de Great Ancoats Street s’étend un grand quartier ouvrier à demi construit, une zone de collines, dénudée, avec des rangées ou des pâtés de maisons isolés, disposés sans ordre. Dans les intervalles, des emplacements vides, inégaux, argileux, sans gazon et par conséquent difficilement praticables par temps humide. Les cottages sont tous sales et vétustes ; ils sont situés souvent dans des trous profonds et rappellent la ville neuve. Le quartier que traverse la voie ferrée de Birmingham est celui où les maisons sont les plus denses, c’est donc le pire.
En cet endroit, les innombrables méandres du Medlock parcourent une vallée qui est par endroits tout à fait analogue à celle de l’Irk. Des deux côtés de la rivière aux eaux stagnantes et nauséabondes, aussi noire que de la poix s’étend, de son entrée dans la ville jusqu’à son confluent avec l’Irwell, une large ceinture de fabriques et de logements ouvriers ; ceux-ci sont dans l’état le plus déplorable. La rive est le plus souvent escarpée et les constructions descendent jusque dans le fleuve, tout comme nous l’avons vu pour l’Irk ; et les rues et les maisons sont aussi mal bâties, qu’elles soient du côté de Manchester ou d’Ardwick, Chorlton ou Hulme. Le coin le plus hideux – si je voulais parler en détail de tous les blocs d’immeubles séparément, je n’en finirais pas – se situe du côté de Manchester, immédiatement au sud-ouest d’Oxford Road et s’appelle « la petite Irlande » (Little Ireland). Dans un creux de terrain assez profond, bordé en demi-cercle par le Medlock, et sur les quatre côtés par de hautes usines, de hautes rives couvertes de maisons ou des remblais, 200 cottages environ sont répartis en deux groupes, le mur de derrière étant le plus souvent mitoyen ; quelque 4,000 personnes y habitent, presque tous des Irlandais. Les cottages sont vieux, sales et du type le plus petit : les rues inégales tout en bosses, en partie sans pavés et sans caniveaux ; partout, une quantité considérable d’immondices, de détritus et de boue nauséabonde entre les flaques stagnantes ; l’atmosphère est empestée par leurs émanations, assombrie et alourdie par les fumées d’une douzaine de cheminées d’usines ; une foule d’enfants et de femmes en haillons rôdent en ces lieux, aussi sales que les porcs qui se prélassent sur les tas de cendres et dans les flaques. Bref, tout ce coin offre un spectacle aussi répugnant que les pires cours des bords de l’Irk. La population qui vit dans ces cottages délabrés, derrière ces fenêtres brisées et sur lesquelles on a collé du papier huilé, et ces portes fendues aux montants pourris, voire dans ces caves humides et sombres, au milieu de cette saleté et de cette puanteur sans bornes, dans cette atmosphère qui semble intentionnellement renfermée, cette population doit réellement se situer à l’échelon le plus bas de l’humanité ; telle est l’impression et la conclusion qu’impose au visiteur l’aspect de ce quartier vu de l’extérieur. Mais que dire quand on apprend (( Dr KAY : op. cit. pp. 35-36. (N.d.E.))) que dans chacune de ces petites maisons qui ont tout au plus deux pièces et un grenier, parfois une cave, habitent vingt personnes, que dans tout ce quartier il n’y a qu’un cabinet -le plus souvent inabordable bien sûr – pour 120 personnes environ et qu’en dépit de tous les sermons des médecins, en dépit de l’émotion qui s’empara de la police chargée de l’hygiène pendant l’épidémie de choléra quand elle découvrit l’état de la Petite Irlande, tout est aujourd’hui, en l’an de grâce 1844, presque dans le même état qu’en 1831 ? Le Dr Kay relate que, dans ce quartier, ce ne sont pas seulement les caves, mais même les rez-de-chaussée de toutes les maisons qui sont humides ; autrefois, un certain nombre de caves avaient été comblées avec de la terre, explique-t-il, mais peu à peu on les a déblayées, et elles sont habitées maintenant par des Irlandais ; dans une cave – le sol de la cave étant au-dessous du niveau du fleuve – l’eau jaillissait continuellement d’un trou d’évacuation obturé avec de l’argile, au point que le locataire, un tisserand manuel, devait chaque matin vider sa cave et verser l’eau dans la rue.
Plus en aval, on trouve Hulme sur la rive gauche de Medlock, ville qui n’est à proprement parler qu’un grand quartier ouvrier et dont l’état est presque en tous points semblable à celui du quartier d’Ancoats. Les quartiers à habitat très dense sont le plus souvent en piteux état et presque en ruines ; les quartiers à population moins dense et de construction assez récente sont plus aérés mais le plus souvent enfouis dans la boue. En général, les cottages sont humides et pourvus d’une arrière-ruelle et d’habitations au sous-sol. Sur l’autre rive du Medlock, à Manchester proprement dit, il existe un second grand district ouvrier, qui s’étend des deux côtés de Deansgate jusqu’au quartier commercial et qui par endroits ne le cède en rien à la vieille ville. Notamment, à proximité du quartier commercial, entre Bridge Street et Quay Street, Princess Street et Peter Street, l’entassement des immeubles dépasse par endroit celui des plus étroites cours de la vieille ville. On y trouve de longues venelles étroites, entre lesquelles il y a des cours avec coins et recoins, et des passages dont les sorties et les entrées sont aménagées avec si peu de méthode que, dans pareil dédale, on s’engage à tout moment dans une impasse ou que l’on sort du mauvais côté, lorsqu’on ne connaît pas à fond chaque passage et chaque cour. C’est dans ces lieux exigus, délabrés et sales qu’habite, selon le Dr Kay, la classe la plus amorale de tout Manchester, dont la profession est le vol ou la prostitution, et selon toute apparence il a raison aujourd’hui encore. Lorsque la police de l’hygiène y vint faire une descente en 1831, elle y découvrit une insalubrité aussi grande qu’aux bords de l’Irk ou dans la « Petite Irlande » (je puis témoigner que ce n’est guère mieux encore aujourd’hui) et entre autres choses, un seul cabinet pour 380 personnes dans la Parliament Street, et un seul pour 30 maisons à grande densité de population dans le Parliament Passage.
Si nous allons à Salford en traversant l’Irwell, nous trouvons, sur une presqu’île formée par cette rivière, une ville qui compte 80,000 habitants et n’est à vrai dire qu’un grand quartier ouvrier traversé par une unique et large rue. Salford, jadis plus importante que Manchester, était à cette époque le centre principal du district environnant qui porte encore son nom : Salford Hundred. C’est pourquoi il y a ici aussi un quartier assez vieux et par conséquent très malsain, sale et délabré, en face de la vieille église de Manchester, et qui est en aussi mauvais état que la vieille ville, sur l’autre rive de l’Irwell. Un peu plus loin du fleuve s’étend un district plus récent mais qui date lui aussi de plus de quarante ans et est pour cette raison passablement décrépit. Tout Salford est bâti en cours ou en ruelles si étroites qu’elles m’ont rappelé les plus étroites venelles que j’aie jamais vues : celles de Gênes. Sous ce rapport, la façon dont Salford est bâtie est encore bien pire que celle de Manchester et il en va de même pour la propreté. Si à Manchester la police s’est rendue, au moins de temps à autre – une fois tous les six ou dix ans – dans les quartiers ouvriers, a fait fermer les plus mauvais logements et nettoyer les coins les plus sales de ces écuries d’Augias, elle semble n’avoir rien fait à Salford. Les étroites ruelles transversales et les cours de Chapel Street, Greengate et Gravel Lane, n’ont certainement jamais été nettoyées depuis leur construction ; actuellement la voie ferrée de Liverpool traverse ces quartiers sur un haut viaduc et elle a fait disparaître maints recoins parmi les plus sales, mais qu’est-ce que cela change ? En passant sur ce viaduc, on peut voir d’en haut encore bien assez de saleté et de misère, et si l’on se donne la peine de parcourir ces ruelles, de jeter un coup d’œil par les portes et fenêtres ouvertes, dans les caves et les maisons, on peut se convaincre à chaque instant, que les ouvriers de Salford vivent dans des logements où toute propreté et tout confort sont impossibles. Même situation dans les districts plus éloignés de Salford, à Islington, près de Regent Road et derrière le chemin de fer de Bolton. Les logements ouvriers entre Oldfield Road et Cross Lane, où, de part et d’autre de Hope Street, se trouve une foule de cours et de ruelles dans un état des plus déplorables, rivalisent de malpropreté et de densité de population avec la vieille ville de Manchester; dans cette région j’ai trouvé un homme qui semblait accuser soixante ans et vivait dans une étable – il avait construit dans ce trou carré sans fenêtres, ni plancher ni sol pavé, une espèce de cheminée ; il y avait installé un grabat et il y habitait, bien que la pluie pénétrât à travers le mauvais toit délabré. L’homme, trop âgé et trop faible pour accomplir un travail régulier, gagnait sa nourriture en transportant du fumier et d’autres choses dans sa brouette ; une mare de purin arrivait presque jusqu’à son étable.
Voilà les différents quartiers ouvriers de Manchester, tels que j’ai eu l’occasion de les observer moi-même durant vingt mois. Pour résumer le résultat de nos promenades à travers ces localités, nous dirons que la quasi-totalité des 350,000 ouvriers de Manchester et de sa banlieue habite dans des cottages en mauvais état, humides et sales ; que les rues qu’ils prennent sont le plus souvent dans le plus déplorable état et extrêmement malpropres et qu’elles ont été construites sans le moindre souci de l’aération, avec l’unique préoccupation du plus grand profit possible pour le constructeur ; en un mot, que dans les logements ouvriers de Manchester il n’y a pas de propreté, pas de confort et donc pas de vie de famille possibles ; que seule une race déshumanisée, dégradée, rabaissée à un niveau bestial, tant du point de vue intellectuel que du point de vue moral, physiquement morbide, peut s’y sentir à l’aise et s’y retrouver chez soi. Et je ne suis pas le seul à l’affirmer ; nous avons vu que le Dr Kay fournit une description tout à fait analogue et par surcroît, je vais mentionner encore les paroles d’un libéral, d’un homme dont l’autorité est reconnue et appréciée des industriels, adversaire fanatique de tout mouvement ouvrier indépendant, M. Senior(( NASSAU W. Senior : Letters on the Factory Act to the Rt. Hon. President of the Board of Trade [Lettres sur la loi des fabriques adressées au très honorable Président du Bureau du Commerce], Chas. Poulett Thomson, Esq., Londres, 1837 ; p. 24. (F. E.))) ;
« Lorsque j’ai parcouru les logements des ouvriers d’usine dans la ville irlandaise, à Ancoats et dans la « Petite Irlande », mon unique surprise a été qu’il soit possible de se conserver en passable santé dans de tels logis. Ces villes – car ce sont des villes par leur extension et leur population – ont été édifiées dans le mépris le plus total de tous les principes, le profit immédiat des spéculateurs chargés de la construction excepté. Un charpentier et un maçon s’associent pour acheter (c’est-à-dire louer pour un certain nombre d’années) une série d’emplacements à bâtir et pour les couvrir de prétendues maisons; en un endroit, nous trouvâmes toute une rue qui suivait le cours d’un fossé, pour avoir des caves plus profondes sans frais de creusement, des caves non pas destinées à faire office de cabinet de débarras ou d’entrepôt, mais bien de demeures pour des hommes. Pas une seule de ces maisons n’échappa au choléra. Et en général, les rues de ces banlieues n’y ont pas de pavés, elles ont un tas de fumier ou une petite mare en leur milieu, les maisons sont adossées les unes aux autres sans aération ni drainage du sol et des familles entières en sont réduites à vivre dans le recoin d’une cave ou d’une mansarde. »
J’ai déjà mentionné plus haut, l’activité inhabituelle que déploya la police de l’hygiène lors de l’épidémie de choléra à Manchester. En effet, lorsque cette épidémie menaça, une frayeur générale s’empara de la bourgeoisie de cette ville ; on se souvint tout à coup des habitations insalubres des pauvres et on trembla à la certitude que chacun de ces mauvais quartiers allait constituer un foyer d’épidémie, d’où celle-ci étendrait ses ravages en tous sens dans les résidences de la classe possédante. Aussitôt, on désigna une commission d’hygiène pour enquêter dans ces quartiers et remettre au Conseil Municipal, un compte rendu exact de leur situation . Le Dr Kay, lui-même membre de la commission, qui visita spécialement chaque district de police, à l’exception du onzième, donne quelques extraits de son rapport. En tout 6,951 maisons furent inspectées – naturellement dans Manchester même, à l’exclusion de Salford et des autres banlieues – 2,565 d’entre elles avaient un besoin urgent d’un badigeon intérieur à la chaux, dans 960 on avait négligé de faire les réparations nécessaires (were out of repair). 939 étaient dépourvues d’installations d’écoulement suffisantes, 1,435 étaient humides, 452 mal aérées, 2,221 dépourvues de cabinets. Sur les 687 rues inspectées, 248 n’étaient pas pavées, 53 ne l’étaient que partiellement, 112 mal aérées, 352 contenaient des mares stagnantes, des monceaux d’ordures, de détritus et autres déchets.
Il est évident que nettoyer ces écuries d’Augias avant l’arrivée du choléra était proprement impossible ; c’est pourquoi on se contenta de nettoyer quelques-uns des plus mauvais coins et on laissa le reste tel qu’il était. Il va de soi que les endroits nettoyés étaient quelques mois plus tard dans le même état de crasse, à preuve la « Petite Irlande ». Quant à l’intérieur de ces demeures, la même commission en dit à peu près ce que nous savons déjà de Londres, d’Edimbourg, et d’autres villes.
« Souvent, tous les membres d’une famille irlandaise sont entassés dans un seul lit ; souvent un tas de paille sale et de couvertures faites de vieux sacs les recouvre tous, en un amas confus d’êtres, que le besoin, l’abrutissement et la licence abaissent pareillement. Souvent les inspecteurs ont trouvé deux familles dans une maison de deux pièces ; l’une des pièces servait de chambre à coucher pour tous, l’autre était la salle à manger et la cuisine communes ; et souvent plus d’une famille habitait dans une cave humide où 12 à 16 personnes étaient entassées dans une atmosphère pestilentielle ; à cette source de maladies et à d’autres s’ajoutait qu’on y élevait des porcs et qu’on y trouvait d’autres sujets d’écœurement de la plus révoltante espèce(( KAY : op. cit., p. 32. (F.E.) )) . »
Nous devons ajouter que de nombreuses familles, n’ayant elles-mêmes qu’une pièce, y reçoivent des pensionnaires et des gens à la nuit contre indemnité, que par surcroît, souvent des pensionnaires des deux sexes couchent dans le même lit que le couple, et que par exemple, le cas d’un homme, de sa femme et de sa belle-sœur adulte couchant dans le même lit fut constaté six fois au moins à Manchester, selon le Rapport sur l’état sanitaire de la classe ouvrière. Les maisons-dortoirs sont très nombreuses ici aussi, le Dr Kay en fixe le nombre à 267 à Manchester même, en 1831, et depuis il a dû s’accroître sensiblement. Chacune accueille 20 à 30 hôtes, hébergeant ainsi, au total, de 5,000 à 6,000 personnes chaque nuit ; le caractère de ces maisons et de leurs clients est le même que dans les autres villes. Cinq ou sept matelas sont étalés par terre dans chaque chambre, sans lits, et on y case autant de personnes qu’il s’en trouve, toutes pêle-mêle. Je n’ai point besoin de dire quelle ambiance physique et morale règne dans ces repaires du vice. Chacune de ces maisons est un foyer de crime et le théâtre d’actes qui révoltent l’humanité et n’auraient peut-être jamais été perpétrés sans cette centralisation imposée de l’immoralité. Le nombre des individus vivant dans des sous-sols est selon Gaskell(( P. GASKELL : The Manufacturing Population of England, its Moral, Social and Physical Condition, and the Changes, which have arisen from the Use of Steam Machinery; with an Examination of Infant Labour « Fiat justitia ». [La population des ouvriers d’usine en Angleterre, son état moral, social et physique, et les changements occasionnés par l’utilisation des machines à vapeur. Avec une enquête sur le travail des enfants. « Que justice se fasse. »] 1833. Décrit principalement la situation des ouvriers dans le Lancashire. L’auteur est un libéral, mais il écrivait à une époque où le libéralisme n’impliquait pas encore de vanter le « bonheur » des ouvriers. C’est pourquoi il est encore sans prévention et a encore le droit de voir les maux du régime existant, en particulier ceux du système industriel. En revanche, il écrivit aussi avant la Factories Inquiry Commission [Commission d’Enquête sur les Usines] et emprunte à des sources douteuses mainte affirmation réfutée ultérieurement par le rapport de la Commission. L’ouvrage, encore que bon dans l’ensemble, doit en conséquence – et aussi parce qu’il confond comme Kay la classe ouvrière en général avec la classe ouvrière des usines – être utilisé avec précaution dans les détails. L’histoire de l’évolution du prolétariat qu’on a trouvée dans l’introduction est, en grande partie, empruntée à cet ouvrage. (F. E.) )) pour Manchester même de 20,000. Le Weekly Dispatch indique « selon des rapports officiels » le chiffre de 12 % de la classe ouvrière, ce qui semble correspondre à ce chiffre ; le nombre des travailleurs étant en gros de 175,000, 12 % font 21,000. Les habitations en sous-sol dans les banlieues sont au moins aussi nombreuses et ainsi le nombre des personnes vivant dans l’agglomération de Manchester au sous-sol, s’élève au moins à 40,000 ou 50,000. Voilà ce qu’on peut dire des logements ouvriers dans les grandes villes. La façon dont est satisfait le besoin d’abri est un critère pour la façon dont le sont tous les autres besoins. Il est aisé de conclure que seule une population déguenillée, mal nourrie peut demeurer dans ces tanières sales. Et il en est réellement ainsi. Les vêtements des ouvriers sont dans l’énorme majorité des cas en très mauvais état. Les tissus qu’on utilise pour leur fabrication ne sont déjà pas les plus appropriés ; la toile et la laine ont presque disparu de la garde-robe des deux sexes et le coton les a remplacées. Les chemises sont en calicot, blanc ou de couleur ; de même les vêtements des femmes sont en indienne et l’on voit rarement des sous-vêtements de laine sur les cordes à linge. Les hommes portent le plus souvent des pantalons de velours de coton ou de quelque autre lourd tissu de coton et des habits et des vestes de la même étoffe. Le velours de coton (fustian) est même devenu le costume proverbial des ouvriers ; « fustian-jackets », c’est ainsi qu’on nomme les ouvriers et qu’ils se nomment eux-mêmes, par opposition aux Messieurs vêtus de drap (broad-cloth), expression qui est employée aussi pour désigner la classe moyenne. Lorsque Feargus O’Connor, le chef des Chartistes, vint à Manchester pendant l’insurrection de 1842, il se présenta dans un costume de velours de coton aux applaudissements déchaînés des ouvriers. Les chapeaux sont, en Angleterre, la coiffure habituelle, même des ouvriers ; ils ont les formes les plus diverses, ils sont ronds, coniques ou cylindriques, à larges bords, à bords étroits ou sans bords. Seuls les jeunes portent des casquettes dans les villes industrielles. Qui n’a pas de chapeau se confectionne avec du papier une toque basse et carrée. Tous les vêtements des ouvriers – même à supposer qu’ils soient en bon état – sont bien peu adaptés au climat. L’air humide de l’Angleterre qui, plus que tout autre, en raison des brusques changements de temps provoque des refroidissements, contraint presque toute la classe moyenne à porter sur le haut du corps de la flanelle à même la peau : des foulards, des vestes et ceintures de flanelle sont d’un usage presque général. La classe ouvrière non seulement ne connaît pas ces précautions, mais elle n’est presque jamais en mesure d’avoir recours pour son habillement au moindre fil de laine.
Or les lourdes cotonnades, plus épaisses, plus raides et plus lourdes que les étoffes de laine, protègent cependant beaucoup moins du froid et de l’humidité. L’épaisseur et la nature du tissu font qu’elles conservent plus longtemps l’humidité et, somme toute, elles n’ont pas l’imperméabilité de la laine foulée. Et, lorsque l’ouvrier peut se procurer un jour un habit de drap pour le dimanche, il lui faut aller dans les « boutiques bon marché » où on lui fournit un mauvais tissu appelé « devils’s dust » , qui « n’est fait que pour être vendu et non pour être porté », et qui se déchire ou se râpe au bout de quinze jours ; ou bien il lui faut acheter chez le fripier un vieil habit à demi élimé, qui a fait son temps et qui ne peut lui rendre service que pour quelques semaines. Mentionnons encore, chez la plupart, le mauvais état de leur garde-robe et de temps à autre la nécessité où ils se voient de porter leurs meilleurs effets au Mont-de-Piété. Cependant, chez un très, très grand nombre, singulièrement chez ceux d’ascendance irlandaise, les vêtements sont de véritables guenilles qu’il est bien souvent impossible de ravauder ou dont il est impossible de reconnaître la couleur originelle, tant on les a reprisés. Les Anglais ou les Anglo-Irlandais les ravaudent cependant encore et sont passés maîtres dans cet art ; de la laine ou de la toile de sac, sur du velours de coton ou vice-versa, peut leur importe ; quant aux authentiques Irlandais immigrés, ils ne reprisent presque jamais, sauf extrême nécessité, lorsque les vêtements menacent de s’en aller en lambeaux ; il est commun de voir les pans de la chemise passer à travers les déchirures de l’habit ou du pantalon ; ils portent, comme dit Thomas Carlyle(( Thomas CARLYLE : Chartism, Londres, 1839, p. 28. Sur Thomas Carlyle, voir plus bas.)) :
« Un costume de guenilles : l’enfiler et l’ôter représente une des opérations les plus délicates à laquelle on ne procède qu’aux jours de fête et à des moments particulièrement favorables. »
Les Irlandais ont également importé la coutume jadis inconnue des Anglais d’aller pieds-nus. Actuellement, on voit dans toutes les villes industrielles, une foule de gens, surtout des enfants et des femmes qui circulent pieds-nus et peu à peu cette habitude gagne aussi les Anglais pauvres.
Ce qui est vrai de l’habillement, l’est aussi de la nourriture. Aux travailleurs échoit ce que la classe possédante trouve trop mauvais. Dans les grandes villes anglaises, on peut avoir de tout et dans la meilleure qualité, mais cela coûte fort cher ; le travailleur qui doit joindre les deux bouts avec ses quelques sous ne peut pas dépenser tant. De plus, il n’est payé que le samedi soir, dans la plupart des cas ; on a commencé à payer le vendredi ; mais cette excellente initiative n’est pas encore généralisée et c’est ainsi qu’il n’arrive au marché que le samedi soir à quatre, cinq ou six heures, alors que la classe moyenne a choisi dès le matin, ce qu’il y avait de meilleur. Le matin, le marché regorge des meilleures choses, mais lorsque les ouvriers arrivent, le meilleur est parti, et même s’il y restait, ils ne pourraient vraisemblablement pas l’acheter. Les pommes de terre que les ouvriers achètent sont le plus souvent de mauvaise qualité, les légumes sont fanés, le fromage vieux et médiocre, le lard rance, la viande maigre, vieille, coriace, provenant souvent d’animaux malades ou crevés, souvent à demi pourrie. Les vendeurs sont, très fréquemment, de petits détaillants qui achètent en vrac de la camelote et la revendent si bon marché précisément à cause de sa mauvaise qualité. Les plus pauvres des travailleurs doivent se débrouiller autrement pour arriver à s’en tirer avec leur peu d’argent même lorsque les articles qu’ils achètent sont de la pire qualité. En effet, comme à minuit, le samedi, toutes les boutiques doivent être fermées et que rien ne peut être vendu le dimanche, les denrées qui se gâteraient s’il fallait attendre le lundi matin sont liquidées à des prix dérisoires entre dix heures et minuit. Mais les neuf dixièmes de ce qui n’a pas été vendu à dix heures n’est plus mangeable le dimanche matin, et ce sont précisément ces denrées qui constituent le menu dominical de la classe la plus misérable. La viande qu’on vend aux ouvriers est très souvent immangeable – mais puisqu’ils l’ont achetée, il leur faut bien la manger.
Le 6 janvier 1844 (si je ne m’abuse), il y eut une session du tribunal de commerce à Manchester, au cours de laquelle onze bouchers ont été condamnés pour avoir vendu de la viande impropre à la consommation. Chacun d’eux avait encore qui un bœuf entier, qui un porc entier, qui plusieurs moutons ou encore 50 ou 60 livres de viande qui furent saisis, tous dans cet état. Chez l’un d’eux, on a confisqué 64 oies de Noël farcies qui, n’ayant pu être vendues à Liverpool, avaient été transportées à Manchester où elles parvinrent au marché avariées et sentant mauvais.
Cette histoire parut à l’époque dans le Manchester Guardian avec les noms et le montant de l’amende. Durant les six semaines du 1° juillet au 14 août, le même journal rapporte trois cas semblables ; selon le n° du 3 juillet, fut saisi à Heywood un porc de 200 livres mort et avarié qui avait été dépecé chez un boucher et mis en vente ; selon celui du 31, deux bouchers de Wigan, dont l’un s’était déjà rendu coupable jadis du même délit, furent condamnés à deux et quatre livres sterling d’amende, pour avoir mis en vente de la viande impropre à la consommation – et selon le n° du 10 août, on saisit chez un épicier de Bolton 26 jambons non comestibles qui furent publiquement brûlés ; le commerçant fut condamné à une amende de 20 shillings. Mais ceci ne rend pas compte de tous les cas et ne représente pas même pour ces six semaines une moyenne d’après laquelle on pourrait établir un pourcentage annuel ; il arrive fréquemment, que chaque numéro du Guardian, qui paraît deux fois par semaine, relate un fait analogue à Manchester ou dans le district industriel environnant – et lorsqu’on réfléchit au nombre des cas qui doivent se produire sur les vastes marchés qui bordent les longues artères et qui doivent échapper aux rares tournées des inspecteurs des marchés – comment pourrait-on expliquer autrement l’impudence avec laquelle ces quartiers de bétail entiers sont mis en vente ? -, lorsqu’on songe combien doit être grande la tentation, vu le montant incompréhensiblement bas des amendes, lorsqu’on songe dans quel état doit être un morceau de viande pour être déclaré complètement impropre à la consommation et confisqué par les inspecteurs – il est impossible de croire que les ouvriers puissent acheter en général une viande saine et nourrissante. Cependant, ils sont encore escroqués d’une autre façon par la cupidité de la classe moyenne. Les épiciers et les fabricants frelatent toutes les denrées alimentaires d’une manière vraiment insoutenable avec un mépris total de la santé de ceux qui les doivent consommer. Nous avons donné plus haut, la parole au Manchester Guardian, écoutons maintenant ce que nous dit un autre journal de la classe moyenne – j’aime à prendre mes adversaires pour témoins – écoutons le Liverpool Mercury :
« On vend du beurre salé pour du beurre frais, soit qu’on enduise les mottes d’une couche de beurre frais, soit qu’on place au sommet de l’étalage une livre de beurre frais à goûter et qu’on vende sur cet échantillon les livres de beurre salé, soit qu’on enlève le sel par lavage et qu’on vende ensuite le beurre comme frais. On mêle au sucre du riz pulvérisé ou d’autres denrées bon marché qu’on vend au prix fort. Les résidus des savonneries sont également mêlés à d’autres marchandises et vendus pour du sucre. On mêle au café moulu de la chicorée ou d’autres produits bon marché, on va jusqu’à en mêler au café en grains, en donnant au mélange, la forme de grains de café. On mêle très fréquemment au cacao de la terre brune fine qui est enrobée de graisse d’agneau et se mélange ainsi plus facilement avec le cacao véritable. On mélange au thé des feuilles de prunellier et d’autres débris, ou bien encore on fait sécher des feuilles de thé qui ont déjà servi, on les grille sur des plaques de cuivre brûlant, pour qu’elles reprennent couleur et on les vend pour du thé frais. Le poivre est falsifié au moyen de cosses en poudre etc… ; le porto est littéralement fabriqué, (à partir de colorants, d’alcool, etc…), car il est notoire qu’on en boit en Angleterre plus qu’on n’en produit dans tout le Portugal ; le tabac est mélangé à des matières écœurantes de toute sorte, sous quelque forme que ce produit soit mis en vente. »
Je puis ajouter qu’en raison de la falsification générale du tabac, plusieurs buralistes de Manchester, parmi les mieux considérés ont déclaré publiquement l’été dernier qu’aucun débit de tabac ne saurait subsister sans ces frelatages et qu’aucun cigare dont le prix est inférieur à trois pence ne contient du tabac pur. Bien entendu, on n’en reste pas aux fraudes sur les denrées alimentaires et je pourrais en citer encore une douzaine – entre autres, la pratique infâme qui consiste à mêler du plâtre ou de la craie à la farine – on fraude sur tous les articles ; on étire la flanelle, les bas etc… pour les faire paraître plus longs et ils rétrécissent à la première lessive ; un coupon d’étoffe étroit est vendu pour un coupon d’un pouce et demi ou de trois pouces plus large , la faïence est recouverte d’un émail si mince qu’elle n’est pratiquement pas émaillée et s’écaille tout de suite, et cent autres ignominies. « Tout comme chez nous », mais ceux qui supportent le plus les conséquences de ces duperies, ce sont les travailleurs.
Le riche, lui, n’est pas trompé, parce qu’il peut payer les prix élevés des grands magasins qui doivent veiller à leur bon renom et se feraient surtout tort à eux-mêmes s’ils vendaient de la camelote et des marchandises frelatées ; le riche, gâté par la bonne chère, remarque plus aisément la fraude grâce à la finesse de son palais. Mais le pauvre, l’ouvrier, pour qui quelques pfennigs représentent une somme, lui qui doit avoir beaucoup de marchandise pour peu d’argent, qui n’a pas le droit ni la possibilité de faire très attention à la qualité, parce qu’il n’a jamais eu l’occasion d’affiner son goût, toutes les denrées falsifiées, voire empoisonnées sont pour lui ; il lui faut aller chez les petits épiciers, peut-être même acheter à crédit et ces épiciers qui, en raison de leur petit capital et des frais généraux assez importants ne peuvent même pas vendre aussi bon marché – à qualité égale – que les marchands au détail plus importants, sont bien contraints de fournir consciemment ou non des denrées frelatées – à cause des prix assez bas qu’on leur demande et de la concurrence des autres. En outre, si pour un gros détaillant, qui a de forts capitaux dans son affaire, la découverte d’une fraude signifie la ruine parce qu’elle lui fait perdre tout crédit, qu’importe à un petit épicier, qui approvisionne une seule rue, d’être convaincu de fraudes ? Si on ne lui fait plus confiance à Ancoats, il s’en va à Chorlton ou à Hulme, où personne ne le connaît et où il recommence à frauder ; et des peines légales ne sont prévues que pour un nombre restreint de falsifications, à moins qu’elles ne s’accompagnent en même temps de fraude du fisc. Mais ce n’est pas seulement sur la qualité mais encore sur la quantité que le travailleur anglais est trompé ; les petits épiciers ont la plupart du temps de fausses mesures et de faux poids et l’on peut lire chaque jour, un nombre incroyable de contraventions pour des délits de ce genre dans les rapports de police. A quel point ce genre de fraude est généralisé dans les quartiers des usines, quelques extraits du Manchester Guardian vont nous l’apprendre ; ils ne concernent qu’un court laps de temps et même pour cette période, je n’ai pas tous les numéros sous la main :
Guardian du 16 juin 1844 – Sessions du tribunal de Rochdale – 4 épiciers écopent une amende de 5 à 10 shillings pour usage de poids trop légers.
Sessions de Stockport : 2 épiciers condamnés à une amende de 1 shilling ; l’un d’eux avait 7 poids trop légers et un plateau de balance truqué, et tous deux avaient déjà reçu un avertissement.
Guard., 19 juin – Sessions de Rochdale : 1 épicier condamné à une amende de 5 shillings et 2 paysans à une de 10 shillings.
Guard., 22 juin – justice de paix de Manchester : 19 épiciers sont punis d’une amende de 2 ½ shillings à 2 livres.
Guard., 26 juin. – Brève session du tribunal d’Ashton : 14 épiciers et paysans punis de 2 ½ shillings à 1 livre sterling d’amende.
Hyde – brève session : 9 paysans et épiciers condamnés aux dépens et à 5 shillings d’amende.
Guard., 6 juillet – Manchester : 16 épiciers condamnés aux dépens et à des amendes allant jusqu’à 10 shillings.
Guard., 13 juillet. – Manchester : 9 épiciers punis d’amendes de 2 ½ à 20 shillings.
Guard., 24 juillet. – Rochdale : 4 épiciers punis de 10 à 20 shillings d’amende.
Guard., 27 juillet. – Bolton : 12 épiciers et hôteliers condamnés aux dépens.
Guard., 3 août. – Bolton : 3 épiciers et hôteliers condamnés à une amende de 2 ½ à 5 shillings.
Guard., 10 août. – Bolton : 1 épicier-hôtelier condamné à 5 shillings d’amende.
Et les mêmes raisons, qui faisaient pâtir en premier lieu les ouvriers de la fraude sur la qualité, expliquent qu’ils aient à pâtir de la fraude sur la quantité.
L’alimentation habituelle du travailleur industriel diffère évidemment selon le salaire. Les mieux payés, en particulier ceux des ouvriers d’usine chez lesquels chaque membre de la famille est en état de gagner quelque chose ont, tant que cela dure, une bonne nourriture, de la viande chaque jour et, le soir, du lard et du fromage. Mais dans les familles où on gagne moins, on ne trouve de la viande que le dimanche ou 2 à 3 fois par semaine et en revanche plus de pommes de terre et de pain ; si nous descendons l’échelle peu à peu, nous trouvons que la nourriture d’origine animale est réduite à quelques dés de lard, mêlés aux pommes de terre ; plus bas encore, ce lard lui-même disparaît, il ne reste que du fromage, du pain, de la bouillie de farine d’avoine (porridge) et des pommes de terre, jusqu’au dernier degré, chez les Irlandais, où les pommes de terre constituent la seule nourriture. On boit en général, avec ces mets, un thé léger, quelquefois additionné d’un peu de sucre, de lait ou d’eau-de-vie ; le thé passe en Angleterre et même en Irlande pour une boisson aussi nécessaire et indispensable que le café chez nous, et dans les foyers où l’on ne boit plus de thé, c’est toujours le règne de la misère la plus noire. Mais ceci est vrai dans l’hypothèse où le travailleur a du travail ; s’il n’en a pas, il est réduit totalement au hasard et mange ce qu’on lui donne, qu’il mendie ou qu’il vole ; et s’il n’a rien, il meurt tout simplement de faim, comme nous l’avons vu précédemment. Il est aisé de comprendre que la quantité de nourriture tout comme la qualité dépendent du salaire et que la famine règne chez les travailleurs les plus mal payés – surtout s’ils ont en outre de lourdes charges de famille – même en période de plein travail ; or le nombre de ces travailleurs mal payés est très grand. Singulièrement à Londres, où la concurrence entre ouvriers croît en proportion directe de la population, cette catégorie est très nombreuse, mais nous la trouvons également dans toutes les autres villes. Aussi bien y a-t-on recours à tous les expédients : on consomme, à défaut d’autre nourriture, des pelures de pommes de terre, des déchets de légumes, des végétaux pourrissants(( Weekly Dispatch, avril ou mai 1844 *, d’après un rapport du Dr Southwood Smith** sur la situation des indigents à Londres. (F. E.)
* Il s’agit probablement de l’exemplaire du 5 mai (cf. également, au sujet de ce rapport, Northern Star du 24 février).
** Le Dr Southwood Smith était, sur ces questions, une autorité reconnue. Il a fait plusieurs rapports en 1838, 39, 40 sur l’état sanitaire des quartiers pauvres de Londres devant des commissions officielles. (Cf. R. A. Lewis : Edwin Chadwick and the Public Health Movement 1832-1854, 1954, pp. 394-395.) )) , et on ramasse avidement tout ce qui peut contenir ne serait-ce qu’un atome de produit mangeable. Et, lorsque le salaire hebdomadaire est déjà consommé avant la fin de la semaine, il arrive fréquemment que la famille, durant les derniers jours, n’ait plus rien ou tout juste assez à manger pour ne pas mourir de faim. Un tel mode de vie ne peut évidemment qu’engendrer une foule de maladies et lorsque celles-ci surviennent, lorsque l’homme, dont le travail fait vivre essentiellement la famille et dont l’activité pénible exige le plus de nourriture – et qui par conséquent succombe le premier – quand cet homme tombe tout à fait malade, c’est alors seulement que commence la grande misère, c’est seulement alors que se manifeste de façon vraiment éclatante, la brutalité avec laquelle la société abandonne ses membres, juste au moment où ils ont le plus besoin de son aide.
Résumons encore une fois, pour conclure, les faits cités : les grandes villes sont habitées principalement par des ouvriers puisque, dans le meilleur des cas, il y a un bourgeois pour deux, souvent trois et par endroits pour quatre ouvriers ; ces ouvriers ne possèdent eux-mêmes rien et vivent du salaire qui presque toujours ne permet que de vivre au jour le jour ; la société individualisée à l’extrême ne se soucie pas d’eux, et leur laisse le soin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille ; cependant, elle ne leur fournit pas les moyens de le faire de façon efficace et durable ; tout ouvrier, même le meilleur, est donc constamment exposé à la disette, c’est-à-dire à mourir de faim, et bon nombre succombent ; les demeures des travailleurs sont en règle générale mal groupées, mal construites, mal entretenues, mal aérées, humides et insalubres ; les habitants y sont confinés dans un espace minimum et dans la plupart des cas il dort dans une pièce, au moins une famille entière ; l’aménagement intérieur des habitations est misérable ; on tombe, par degré, jusqu’à l’absence totale des meubles les plus indispensables ; les vêtements des travailleurs sont également en moyenne médiocres et un grand nombre sont en guenilles ; la nourriture est généralement mauvaise, souvent presque impropre à la consommation et dans bien des cas, au moins par périodes, insuffisante, si bien qu’à l’extrême, il y a des gens qui meurent de faim. La classe ouvrière des grandes villes nous présente ainsi un éventail de modes d’existence différents, – dans le cas le plus favorable une existence momentanément supportable : à labeur acharné bon salaire, bon logis et nourriture pas précisément mauvaise – du point de vue de l’ouvrier évidemment, tout cela est bon et supportable – au pire, une misère cruelle qui peut aller jusqu’à être sans feu ni lieu et à mourir de faim ; mais la moyenne est beaucoup plus proche du pire que du meilleur de ces deux cas. Et n’allons pas croire que cette gamme d’ouvriers comprend simplement des catégories fixes qui nous permettraient de dire : cette fraction de la classe ouvrière vit bien, celle-là mal, il en est et il en a toujours été ainsi ; tout au contraire ; si c’est encore parfois le cas, si certains secteurs isolés jouissent encore d’un certain avantage sur d’autres, la situation des ouvriers dans chaque branche est si instable, que n’importe quel travailleur peut être amené à parcourir tous les degrés de l’échelle, du confort relatif au besoin extrême, voire être en danger de mourir de faim ; et d’ailleurs il n’est presque pas de prolétaire anglais qui n’ait beaucoup à dire sur ses considérables revers de fortune. Ce sont les causes de cette situation que nous allons examiner maintenant de plus près.